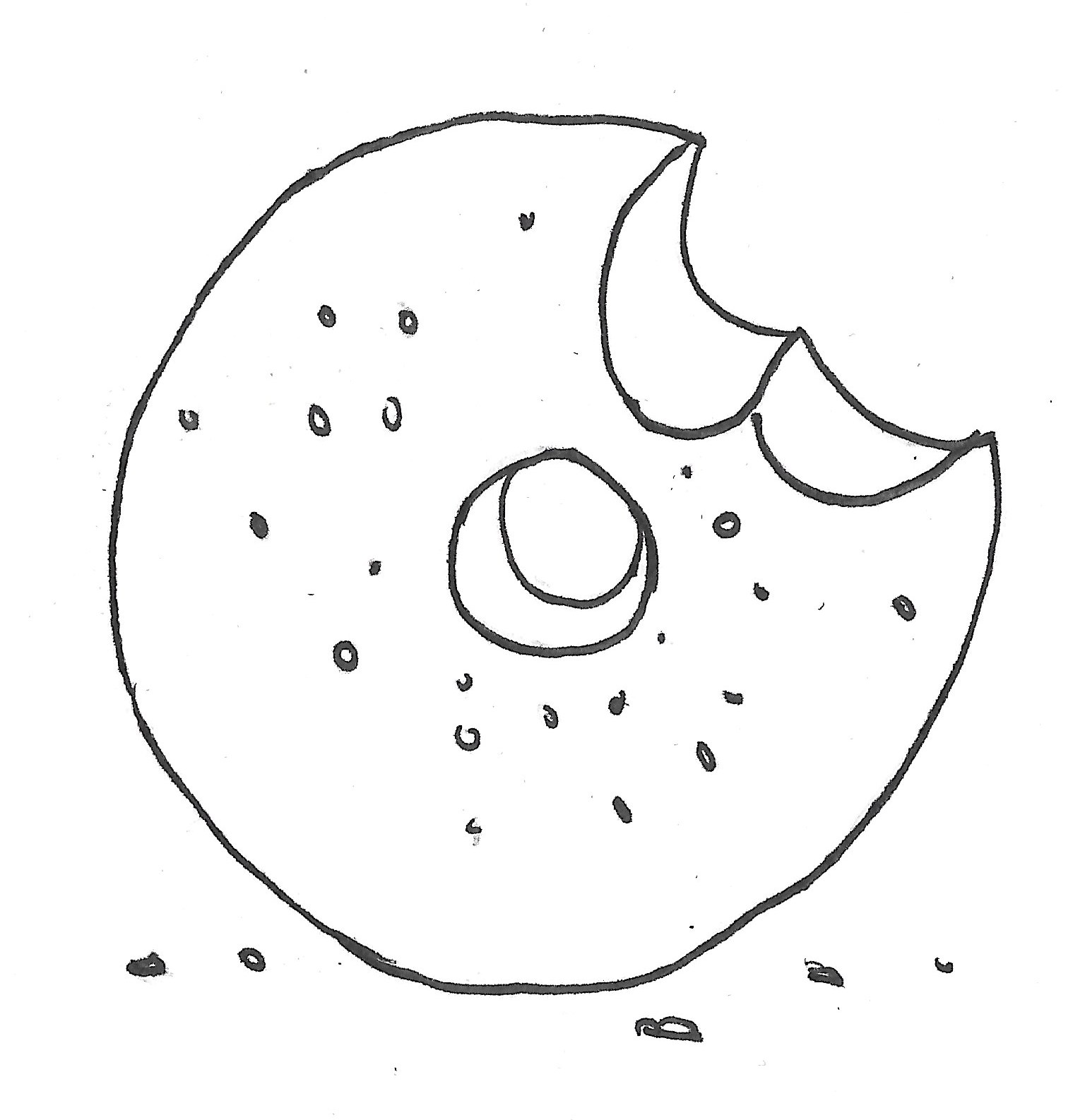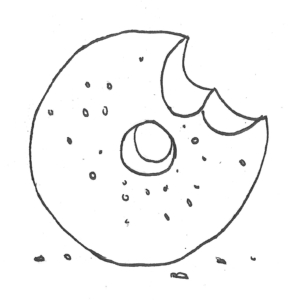Au deuxième rendez-vous, je reçois un devoir. Ma psy me demande de dessiner mon autoportrait.
Facile, j’ai toujours aimé dessiner.
Le soir même, je trouve des pastels gras qui traînent dans l’armoire à bricolage et je tente de tracer une tête, un visage précis. Recommence, quatre fois. Chaque fois, les traits ratent leur cible. L’image devient tendancieuse, malhonnête. Il me semble qu’un autoportrait juste doit montrer quelque chose d’horrifiant. Quelque chose qu’on ne veut pas voir, qu’on préfère ignorer.
J’ai peur de me blesser.
Je manque abdiquer. J’hésite entre rire ou pleurer. Et c’est là que je sais.
J’en fais deux. Deux visages sur deux feuilles distinctes. Le fait de m’appliquer à la tâche me permet d’affronter ce qui émerge du papier.
D’un côté, une bouche souriante aux lèvres généreuses, de grasses pommettes rouges, des yeux plissés, hilares, un chignon de cheveux roux montant en l’air comme une torche qu’on viendrait de suralimenter en huile.
De l’autre, une icône triste, sans bouche, aux joues concaves et au cou sec. Des yeux blancs, absents, sous un grand crâne chauve. Des clavicules saillantes. Ce sont elles seules qui parlent, qui traduisent, à leur manière, le langage éteint du regard.
La psy est ravie. En silence, elle analyse mon duo avec attention. À ma surprise, elle ne le commente pas. Tout ce qu’elle dit est que je dessine bien et qu’elle applaudit mon courage.
À la fin de son examen, elle plante ses yeux amis dans les miens et me demande à laquelle des deux figures je m’identifie le plus.
Je ne sais pas.
Celle que tu aimes le plus ?
La rieuse. Mais je sens qu’elle n’est pas forte en ce moment.
On va la ramener.
La psy me promet, et malgré moi, j’ose la croire.