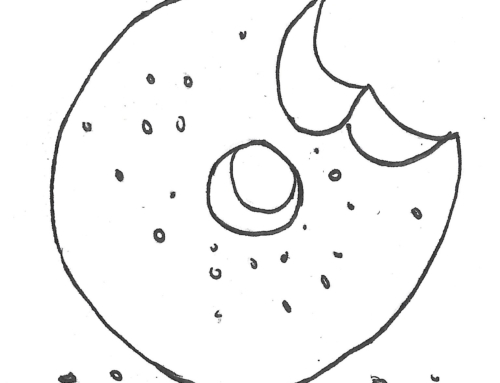Hiver. Basse-ville de Québec.
Il paraît qu’au Québec, on parle beaucoup du temps qu’il fait. Dans mon quartier, presque toutes les conversations entre voisins commencent par un commentaire sur la météo. C’est poli, jaser de météo, ça dit entre les lignes qu’on reconnaît la présence de l’autre, qu’on désire entrer en contact. Qu’on partage un vécu commun. Qu’on a la délicatesse de ne pas poser de questions personnelles. Qu’on reconnaît, même dans les quartiers centraux où on vit les uns sur les autres, la valeur de l’intimité.
On se révèle bien plus qu’il n’y paraît à travers ces conversations banales. Un rapport au temps et à l’espace, une manière de percevoir, des traits de caractère. Guy était un optimiste qui voyait un avantage à toutes les conditions météo – la pluie lavait les rues, le verglas brillait joliment et le soleil qui tapait fort sur le bitume lui offrait un prétexte pour ouvrir une bière dès midi. Julie sortait toujours parfaitement habillée en fonction du mercure. François se plaignait, beau temps, mauvais temps, que c’était inconfortable et qu’on n’y pouvait rien.
Rue Kirouac, j’habitais dans un petit bloc de quatre logements, à peine isolé, à quelques coins de rue du bar éponyme, connu pour ses soirées karaoké. Dans mon immeuble, on en savait beaucoup les uns sur les autres, parce que les sons et les odeurs traversaient les murs. Dans le temps des fêtes, ça sentait les pâtés à la viande de Louise, ma voisine d’à côté, jusque dans ma chambre. Le réveil de mon voisin d’en bas sonnait tous les matins à huit heures. On savait qui se levait la nuit pour prendre un verre d’eau, qui passait une mauvaise journée, qui commandait du poulet rôti. On savait la couleur des draps séchant sur la corde, le ton des conversations, les allées et venues.
Il existait une sorte de délicatesse entre nous. Peu importe ce qu’on connaissait de l’intimité des autres, on n’en parlait pas à moins que la personne n’aborde le sujet directement dans une conversation. L’essentiel de nos échanges se déroulait sur le balcon en arrosant les plantes, dans les marches de l’escalier extérieur ou au bord du trottoir, accotés sur une pelle.
Robert et Louise, qui vivaient à côté, occupaient le même logement depuis vingt-cinq ans. Ils avaient chacun leur température préférée. Les jours de grandes chaleurs, Robert s’assoyait sur le balcon, en bedaine, avec son poste de radio. Le soir, quand il faisait frais, Louise sortait jaser un moment. Je ne les ai jamais vus dehors en même temps.
Le petit garçon de l’appartement qui se trouvait en bas, en diagonale par rapport au mien, était le seul qui n’avait pas encore conscience des frontières invisibles de nos intimités. Il ne savait pas qu’il était poli de tourner la tête en montant l’escalier, pour ne pas sembler regarder par la fenêtre de ma cuisine. Avec lui on ne parlait pas de météo. Il me racontait toujours, lorsque je passais, quelque chose à propos de ce qu’il était en train de faire dans l’immédiat. Regarde, j’ai lavé mon bonhomme Spiderman. J’ai un bobo sur le bras. Mon château s’est brisé. Regarde, j’ai un camion rouge. J’ai ramassé des fraises. J’ai trouvé un escargot.
Il montait régulièrement sur mon balcon pour voir les fleurs et les tomates en pots. Il touchait à tout, arrachait des pétales et oubliait parfois une auto miniature. Tout à coup, sa tête blonde apparaissait à la fenêtre de la cuisine, et je m’apercevais que je portais encore mon pyjama. C’était le Petit Prince, version Saint-Sauveur.
Mon souvenir météo le plus marquant à propos de l’appartement de la rue Kirouac est le lever de soleil, le matin de mon départ. J’ai failli ne pas le voir. Les déménageurs, qui m’avaient paru très jeunes et joviaux à leur arrivée, se sont arrêtés sur le balcon entre deux allers-retours, et ont sorti leur téléphone cellulaire pour prendre une photo. L’un d’eux a dit quelque chose à propos de la ville, un peu gêné. Que pour quelqu’un qui vivait en banlieue, c’était beau, la ville, au lever du soleil. Nous étions au milieu de l’hiver et le jour se levait tard, vers sept heures trente. Il ne faisait pas assez froid pour que je m’inquiète des mains nues des garçons. J’ai regardé, alors, dans la même direction que l’adolescent. Le ciel rosissait en haut du cap couvert de neige et d’arbres nus. En bas du cap s’alignaient les maisons hétéroclites assemblées au hasard, dont on voyait surtout la face arrière et les cours intérieures. On avait l’impression de se trouver derrière le décor.