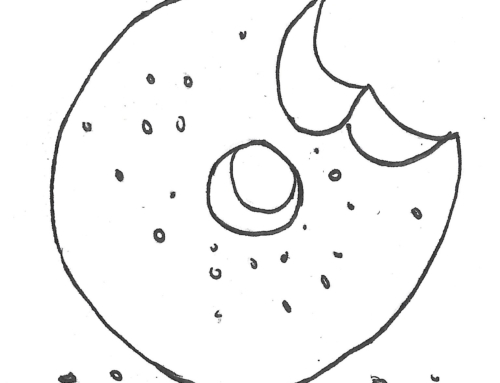Ça ne lui tentait pas, lui, de voyager avec nous.
Quelques souvenirs : voir la mer pour la première fois, la plage de Labadie, et manger un poisson frais pêché. Mon père qui me dit que la tête, pour beaucoup d’Haïtiens, est la partie la plus prisée. Qu’enfant, il se disputait avec ses frères et sœurs pour avoir les yeux, mais que maintenant, il ne pouvait plus en manger. Au Cap, voir mon lavage, mes repas, le ménage de ma chambre, fait par un restavèk plus jeune que moi. Rencontrer un soir un blanc qui nous adresse la parole dans un français très créolisé. Mon père nous a dit qu’il fait partie des descendants d’immigrants italiens, qu’il y en a pas mal, dans le nord du pays. Voir le cadavre d’un homme, le dos éclaté, sur une rue achalandée de Port-au-Prince, du tap-tap dans lequel on roulait. Acheter aux marchands de rue non pas des bouteilles d’eau, mais des petits sacs d’eau, en plastique transparent, dans lesquels on plante une paille. À la plage, me faire interdire d’entrer déchaussée dans la salle de bain publique par des militaires armés de longs fusils.
Le premier souvenir : descendre de l’avion, l’air chaud et pesant, me demander, est-ce que ça sent aussi chez moi, ici?
Dans les tap-tap que l’on prenait plusieurs fois par jour, on demandait parfois à mon père ce que ses filles métisses faisaient là, avec lui. N’étaient-elles pas racistes? Les métisses traditionnellement, paraît-il, n’aiment pas être mêlés aux Noirs; ils ont toujours fait partie de plus hautes classes sociales. Dans les tap-tap, nous détonnions, ma sœur et moi; nous étions trop pâles et nous ne parlions pas assez créole pour comprendre ce qu’on chuchotait en nous dévisageant.
Des années plus tard, je réalise en effet combien ma sœur et moi devions être visibles lors de ce voyage. Ma sœur, un peu plus jeune que moi, encore enfant, portait des robes qui avaient d’abord été les miennes, en coton coloré. Des robes de marques françaises, que ma mère trouvait à prix réduit dans les entrepôts de la rue Chabanel. À l’aube de la puberté, j’arborais fièrement plateformes à la Spice Girls et tour de cou en plastique. Quand nous marchions dans les rues du Cap, dans celles de Port-au-Prince, quelque chose devait bien indiquer que nous venions un peu de là mais surtout d’ailleurs.
Mon père, qui rentrait au pays natal pour la première fois depuis une dizaine d’années, parlait un créole cassé, un créole qui ne connaissait pas les nouvelles expressions à la mode, un créole aux intonations québécoises qu’il n’employait plus que pour parler à ses sœurs. Alors qu’il marchandait le prix des ânes qui devaient nous mener en haut de la Citadelle, forteresse emblématique de la ville où il est né, il s’est fait demander s’il n’était pas africain, par hasard.
La deuxième fois que je suis partie en voyage, c’était des années plus tard, à dix-huit ans. À Paris. La France était mon rêve de petite fille qui lisait Colette et Ann Scott. J’en rêvais tout le temps. Je pense que j’imaginais sans doute que je serais enfin à ma place, là-bas. J’y ai rejoint ma meilleure amie qui faisait un stage d’archéologie quelque part dans la campagne française. Son père, un businessman qui vivait dans un hôtel en Asie depuis des années, nous avait payé une chambre au Ritz avec les points amassés sur sa carte de crédit. Le matin, au petit déjeuner, nous étions les seules à nous faire demander nos noms et notre numéro de chambre par des employés suspicieux. Le Ritz était un décor qui ne nous convenait pas. Corinne et moi portions des jeans Miss Sixty avec des t-shirts de groupes rock, beaucoup de couleurs, beaucoup de bijoux. On adorait les grosses boucles d’oreille dorées des années quatre-vingt. Les gens s’adressaient surtout à nous en anglais, se surprenaient qu’on parle français. Corinne et moi avions l’air, disaient-ils, américaines. Ou espagnoles. Ou brésiliennes. Corinne est en fait eurasienne, elle a de longs cheveux raides noirs et brillants; quant à moi, l’été de mes dix-huit ans, j’avais mis 300 dollars sur ma carte de crédit pour devenir blonde. Mais les gens regardent vite, regardent mal, et parce que nos peaux lorsqu’elles bronzent prennent une teinte similaire, ont souvent pensé que nous étions sœurs. À Montréal, personne n’a jamais suspecté qu’un lien de famille nous unissait, mais à New York, quelques années après notre voyage à Paris, un vendeur dans la rue nous a dit, Are you twins. Nous avons éclaté de rire, répondu No, really, really not.
Les premiers jours de mon voyage à Cuba, l’été dernier, j’ai bien observé comment les Cubaines s’habillaient. Des couleurs franches, peu de maquillage, à part parfois un rouge à lèvres très rouge ou très rose. Mes années de cours d’espagnol étaient loin derrière moi. Ça m’a pris quelques jours pour comprendre un peu l’espagnol cubain, les « s » que l’on ne prononce pas. Petit à petit, j’ai décidé de ne pas porter ce qui faisait trop montréalais à La Havane. Et puis, j’ai eu l’impression que Cuba avait un peu déteint sur moi, que j’avais pris de ce qui me semblait à la fois la langueur et la vivacité cubaine, et pour la première fois de ma vie, à Cuba, j’ai cru avoir l’air de venir très exactement de l’endroit où je me trouvais. La plupart des filles que je croisais auraient pu être mes sœurs, à Cuba. Bien sûr, pour préserver l’illusion, il fallait que je me taise. C’était à mon amoureux blanc, né à Limoilou et qui parle espagnol comme un vrai Cubain, d’expliquer, quand je n’y arrivais pas, que j’étais québécoise.