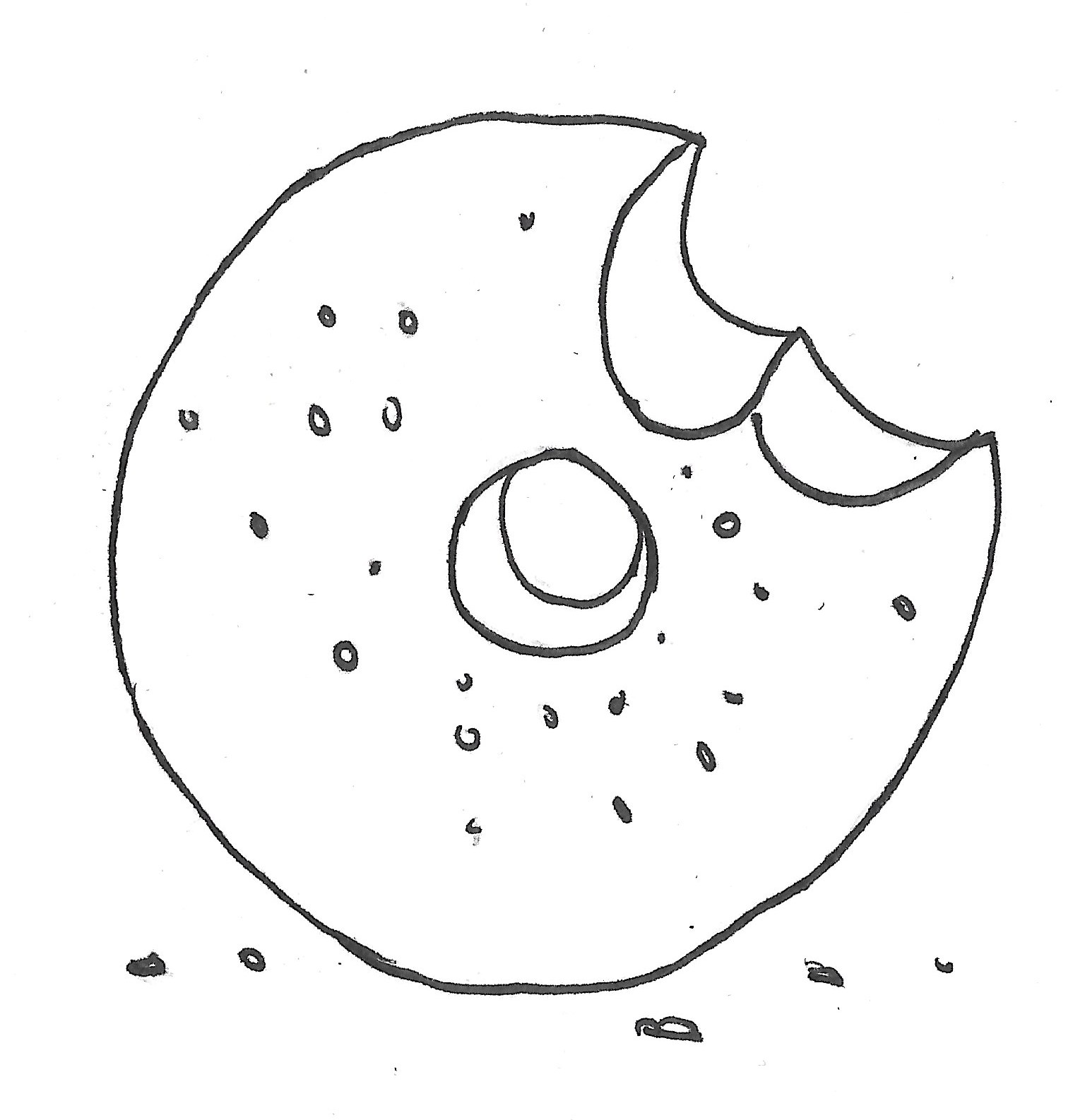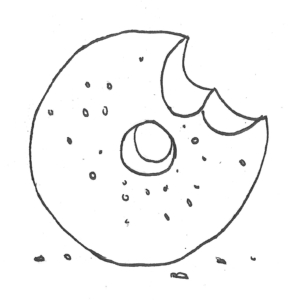Je descends à la station Côte-des-Neiges pour la deuxième fois de ma vie. La première fois était à l’hiver de mes dix ans, pour voir les crèches à l’Oratoire. Aujourd’hui, un samedi de juin déjà trop chaud, j’accomplis un autre genre de pèlerinage avec ma mère. Elle jugeait bon me faire visiter le campus d’avance, anticipant la rentrée, le stress des locaux introuvables et de la nouveauté des transports en commun. J’ai été acceptée au bac en création littéraire à l’Université de Montréal, premier pas vers l’écriture de mon roman.
En avançant sur Jean-Brillant, le visage changeant de ma mère témoigne de la fulgurance de ses souvenirs de graduation, quelque trente ans plus tôt. Ma mère a toujours voulu écrire, mais ne l’a jamais fait. Elle s’est tournée vers l’enseignement après un passage en journalisme: le milieu des lettres est précaire. Je décide que ce sera mon nouveau chemin de croix.
En entrant dans le pavillon, une énergie nouvelle me traverse. Je ne sais pas si c’est la froideur du bâtiment, son odeur d’imprimante et d’intellectualité, mais je sens qu’il se jouera ici quelque chose de spécial. La vue d’un auditorium géant me procure un doux vertige, celle de la bibliothèque me rassure. Mon futur cloître, où je me consacrerai à une discipline similaire à celle envers mon corps.
On va luncher dans un café sur Côte-des-Neiges. Ma mère me demande si j’ai un projet d’écriture cet été. Un roman, presque commencé d’ailleurs. Elle s’enquiert de son sujet. J’explique en agitant mes paumes qu’il aura deux volets, un autoportrait double. Parce qu’on ne peut pas tout saisir d’un coup. Ses questions m’exaltent, concrétisent l’existence de mon texte. Ma fourchette fait crisser la porcelaine. Je finis par baisser les yeux vers mon assiette. En parlant, j’ai terminé mon bol de quinoa.