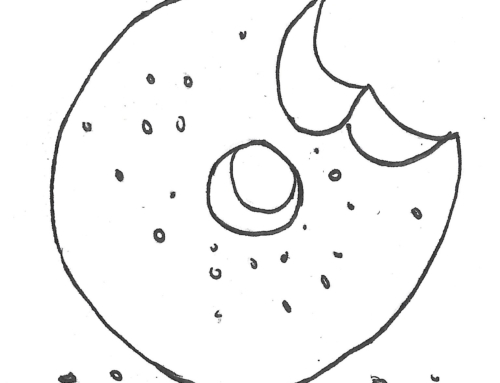Zelig est un drôle de personnage, le protagoniste d’un documentaire avec des images d’archives fictives provenant de différentes époques. Zelig est une énigme, il traverse l’histoire; parmi les noirs, il devient noir; parmi les nazis, il devient un nazi. Son corps change, il est caméléon, il prend la forme qu’exige son environnement. Je ne crois pas que mon père soit un Zelig, mon père ne change pas, il reste le même, je pense que je voudrais au contraire déformer mon père, le transformer, pourquoi ne ferais-je pas de mon père quelqu’un d’autre afin de mieux le comprendre? Je voudrais le placer dans un palais des miroirs et n’en garder que les reflets, que son image agrandie, plus petite, plus grande, plus grosse, ne garder que ce qui est inconnu.
Ma mère a quitté mon père il y a déjà quelques années, avec lui elle a eu quatre enfants plusieurs animaux une maison des joies des tristesses, ces temps-ci, son truc est de dire, J’ai vécu vingt-cinq ans avec lui, je croyais le connaître, mais je le connaissais pas. Lorsqu’elle dit cela, elle fixe le vide. Mon père ment-il, a-t-il toujours menti, ou ne se rappelle-t-il de rien désormais? Il fait depuis une décennie maintenant des crises d’épilepsie qui laissent des empreintes sur son cerveau, épilepsie atypique, dit-on, laissant de grosses cicatrices qui bouffent sa mémoire, il se rappelle de moins en moins des choses, et note au fur et à mesure dans un petit carnet ses rendez-vous, les choses à ne pas oublier. Il ne lui reste plus rien, nous dit-il souvent, que nous, ses enfants, Vous êtes ma raison de vivre, nous dit-il constamment, nous gavant, nous étouffant, nous enrubannant de son amour et continuant à cacher dans le jardin, sous le patio, dans sa chambre que désormais il barre à clé, des bouteilles d’alcools cheaps, mon père boit aussi de la mauvaise bière, beaucoup, ça annule l’effet de ses médicaments qu’il prend de toute façon de manière erratique. Quand il fait des crises d’épilepsie, il se fait dessus, ensuite, ça lui prend des jours à se remettre à parler, ses premiers mots sont des balbutiements, on dirait qu’il parle une langue inconnue, une langue fausse, une langue inventée. Et après c’est toujours la même chose, il dit que c’est sa première crise, aux infirmières, il dit, Je n’ai jamais été malade, que se passe-t-il.
une décennie que c’est comme ça
je lui ai souvent réexpliqué les choses
qu’il était malade
qu’il ne devait pas boire
j’ai souvent recommencé
jusqu’à arriver au bout de ma patience
Dans mon premier livre, j’ai écrit un poème sur ma mère et un poème sur mon père. Ma mère a eu de la difficulté à gérer cela, elle m’a dit que je manquais de décence, elle me demandait pourquoi j’écrivais des textes aussi violents. Qu’habituellement, les gens attendent que leurs parents meurent avant d’écrire sur eux, comme Gwenaëlle Aubry. « [T]ant qu’il était vivant, ça aurait été un livre noir, plein d’aveux et de violence », dit-elle. Plus loin, elle avoue aimer « mieux [son père] mort que vivant ». Le problème avec tout ça, c’est que, comme on se le dit souvent, mes frères, ma sœur, ma mère et moi, mon père nous enterrera tous. Malgré ces problèmes de santé, il reste vigoureux, fort. Indestructible. Son corps est étrangement musclé même s’il n’a pas fait de sport depuis quarante ans. Son père à lui, mon grand-père haïtien que je n’ai vu qu’une fois, qui portait ce si beau prénom, Magloire, est mort l’année dernière à plus de cent ans. Sans doute mon père ne mourra-t-il jamais, il est de la race de ceux qui vivent pour toujours, un corps de roc dont j’ai peut-être hérité. J’ai des os forts, un sang fort, je le crois, mais le tout a été mâtiné du sang de ma mère, j’ai l’impression que ça a affaibli ma génétique, le côté blanc. Par chez elle, les gens sont aussi un peu fous, peut-être que les fous du côté de mon père et les fous du côté de ma mère se sont annulés en se rencontrant dans mes veines, je ne sais pas, ou peut-être qu’au contraire ces aïeux distillent dans mon sang un poison létal. Ce n’est pas grave, je n’ai jamais voulu vivre trop vieille. Je n’ai jamais eu l’impression que j’étais destinée à l’immortalité. S’il faut que je crève avant mon père, sans doute urge-t-il que j’écrive sur lui, j’ai beaucoup de choses à régler, j’ai beaucoup de questions à lui poser, mais je n’ose pas le faire lorsque je le vois. Je le vois très peu, le voir me brûle, ça me prend des jours à m’en remettre, de sa maison sale aux plafonds craquelés, de la salle de bain où les tournevis traînent à côté des brosses à dents, des peintures représentant de coquillages qui étaient dans la salle de bain du temps de ma mère et qui désormais, trônent, ridicules, au salon. C’est vrai, je m’en remets mal, des yeux vitreux de mon père, de ses pantalons à la fermeture éclair toujours déficiente, de son odeur de tabac froid, oui, laissez-moi vous parler de mon petit drame lorsqu’il se ressert du vin en me disant toujours les mêmes choses, Je peux boire du rouge, du blanc, ça me fait vomir, mais du rouge, tout va bien, oui, tout va merveilleusement bien dans le meilleur des mondes, mon père ne mourra jamais. Il suinte la mort, mais cette mort-là je la prends dans ma bouche, je l’avale, je la gobe et elle couve en mon sein, grandit, et un jour, peut-être qu’elle m’avalera toute entière.