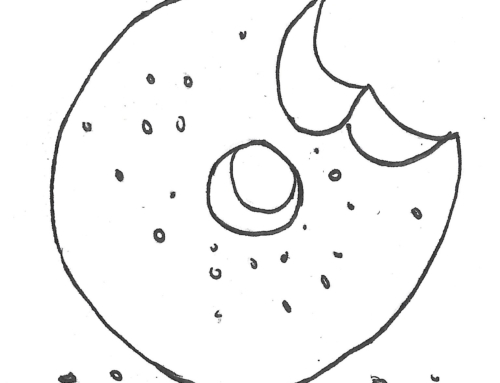C’était une de ces semaines collantes d’été, sans nuages ni vent, qui ne finissait plus. Même les murs de l’appartement semblaient gorgés d’humidité. La chaleur, prisonnière des vieux immeubles mal isolés et du bitume, écrasait le paysage. On espérait un orage, qui tardait à éclater. Des odeurs de pourriture fermentée montaient des poubelles et des égouts. Des amas hétéroclites d’objets et de meubles bloquaient parfois le trottoir, abandonnés lors des déménagements du premier juillet.
Ce dimanche-là, Fred et moi sommes sortis tôt exprès, pour notre première marche de la journée. J’aurais préféré dormir plus longtemps, mais entre neuf heures du matin et huit heures du soir, l’été, en ville, pendant les vagues de chaleur, le béton des trottoirs chauffé par le soleil devenait trop brûlant pour les coussinets de Fred. En descendant l’escalier extérieur, nous avons croisé le Petit Prince qui jouait déjà sur son balcon, en bas, avec ses autos miniatures. Il s’est empressé d’annoncer notre passage à sa mère, à travers la moustiquaire de la porte. « C’est Fred ! Maman, c’est Fred ! » Nous avons échangé un signe de main. Ça sentait le café jusque dehors.
J’ai laissé Fred décider de notre trajet. Il semblait suivre une piste nouvelle, le nez presque collé au sol, pressé. Il s’arrêtait à peine pour marquer les poteaux de téléphone. Ça faisait longtemps qu’il n’avait pas trotté si vite, et je le suivais comme je pouvais, essoufflée, mais ravie de le voir soudain rajeuni. Le soleil commençait tout juste à monter dans le ciel et je transpirais déjà de la racine des cheveux. La ville semi-endormie, silencieuse, paraissait en même temps hideuse et belle.
Ce matin-là, la piste que suivait Fred nous a conduits jusque dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Nous avons monté l’escalier des Franciscains, puis suivi la rue Saint-Jean et ensuite la rue d’Aiguillon. Nous avons descendu la côte d’Abraham jusqu’à Saint-Vallier Est. Je n’ai jamais su qui nous poursuivions ainsi. Soit nous avons perdu la piste des odeurs quelque part, soit Fred a fini par se fatiguer et nous a ramenés à la maison.
Je me souviens d’avoir croisé sur le chemin du retour quelques chiens du quartier que je reconnaissais. Gouverneur, fidèle à son habitude, s’est écrasé comme une crêpe sur le trottoir en voyant Fred, de sorte que son humain a dû le transporter dans ses bras jusqu’au coin de rue suivant, un sourire résigné aux lèvres. J’ai salué de loin un grand berger allemand, que je voyais à toute heure assis sur le siège du passager d’un pick-up bleu rempli de ferraille qui faisait le tour du quartier tous les jours. Son maître m’avait raconté une fois avoir recueilli le chien de son fils décédé. Il avait ajouté que l’animal était farouche et qu’il ne fallait pas trop l’approcher. J’ai aussi vu un groupe de deux hommes et cinq chiens de diverses tailles que je croisais souvent sur la rue Châteauguay, le matin. Trois d’entre eux, qui marchaient sans laisse, sont venus saluer Fred en courant autour de lui, comme si c’était une fête de le retrouver.
Avec Fred, j’ai véritablement exploré les rues de la ville et, grâce à lui, j’ai rencontré plusieurs de mes voisins. Il adorait marcher, malgré son âge avancé, et son physique de chien-ours attirait les regards. Nous connaissions tous les parcs et toutes les fontaines, les coins où trouver de l’ombre, ceux où il restait encore de beaux arbres anciens. Nous aimions beaucoup le parc des Braves, auquel on pouvait accéder, l’été, par un escalier dissimulé dans la côte de la Pente-Douce. Nous aimions aussi les grands arbres autour de l’église Saint-Malo, et les pommiers en fleurs le long de la rivière Saint-Charles, au printemps.
Le Petit Prince n’était plus là quand nous sommes arrivés chez nous. J’ai appris un peu plus tard qu’il était parti cueillir des fraises avec ses parents, sur l’île d’Orléans, pour fuir la chaleur de la basse-ville. Il est monté en déposer quelques-unes devant ma porte.