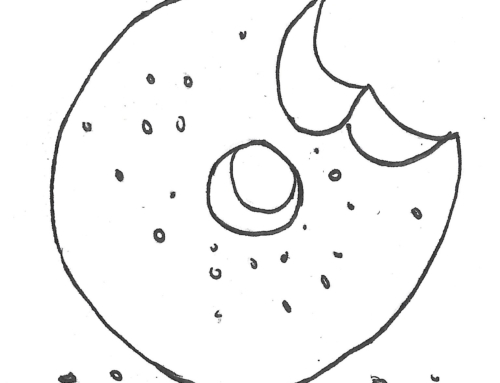5. La recherche création a-t-elle un avenir hors de l’université?
Par “méta-art”, je désigne l’action de rendre explicites les raisonnements, les opérations et les présuppositions liées à l’art que l’on fait, de quelque genre que ce soit ((Texte original : « By “meta-art” I mean the activity of making explicit the thought processes, procedures, and presuppositions of making whatever kind of art we make. »)). (Piper, 1996 : 17)
La prépondérance du contenu sur la forme
Les développements de l’art occidental entre le 16e siècle (environ) et les années 1960 montrent une évolution qui a d’abord vu s’établir la notion d’art telle que nous la connaissons aujourd’hui, englobant tous les arts dans un même concept de l’Art, puis les préoccupations de l’artiste passer d’essentiellement esthétiques à philosophiques. Selon Arthur Danto (1989 : 107), cette progression confirme la théorie de l’histoire d’Hegel ((« Ainsi, l’évolution de l’art confirme virtuellement la théorie hégélienne de l’histoire, selon laquelle l’Esprit est destiné à devenir conscient de lui-même » (Danto, 1989 : 107).)), qui avait prédit une prépondérance toujours croissante du contenu sur la forme. Dans son Esthétique, en effet, Hegel développait un curieux système à trois phases qui aurait présidé à l’évolution de l’art : la première, archaïque (Hegel dit « symbolique »), où la forme excède le contenu, la seconde, classique, où la forme et le contenu sont en équilibre et la troisième, romantique, où le contenu excède la forme ((Voir l’excellente présentation de ces idées par Schallum Pierre (2011).)). Dans cette vision le contenu, au sens général, est évidemment l’esprit humain et cette évolution vers une prépondérance du contenu est un mouvement vers une toujours plus grande intériorisation et subjectivité. Hegel donne en exemple un passage de ces arts plus matériels, et donc extériorisés, que sont l’architecture et la sculpture vers ces arts plus immatériels que sont (dans l’ordre) la peinture, la musique et la poésie. De la poésie, plus immatérielle que tout, Hegel dit notamment :
Par là se détruit la fusion du contenu et de la forme à un degré qui commence à ne plus répondre à l’idée originelle de l’art. De sorte que maintenant la poésie court le danger de se perdre elle-même en passant de la région sensible dans celle de la pensée purement spirituelle. (Cité par Pierre, 2011 : 43)
Bien sûr, les tentatives hégéliennes de systématiser la marche désordonnée de l’humanité apparaissent quelque peu dérisoires à nos esprits postdéconstructionnistes, d’autant plus que l’architecture et la poésie ont toujours coexisté : nous ne sommes pas passés de l’une à l’autre. Mais tout alambiqué que puisse nous sembler ce système en trois phases (qui, incidemment, se « résout » dans la disparition de l’art), l’idée d’une évolution des contenus de l’art de l’idéal vers une vision toujours plus intérieure et subjective me semble dire quelque chose sur la situation d’aujourd’hui. De même la soumission de la forme aux impératifs du contenu et la dématérialisation de l’œuvre au profit du concept, qui sont des réalités contemporaines.
Mais après la phase conceptuelle exploratoire qui va de Duchamp à Kosuth (disons) et qui a pu laisser croire qu’il ne serait plus pertinent, et contrairement tant à la prédiction de Hegel qu’au souhait de Platon, l’art n’est pas disparu, il ne s’est pas fondu dans la philosophie. Il a plutôt repris de plus belle, avec cette particularité que le contenu est devenu de plus en plus prédominant. Et par contenu, j’entends toute la dimension de l’esprit de l’œuvre : son concept, son intentionnalité, ses fondements discursifs, voire dans bien des cas, sa thèse. Ce qui se pose alors comme défi à l’artiste, c’est de rendre compte de cette dimension – ou du moins, de ses aspects les plus intéressants – quand l’œuvre elle-même n’est pas explicite à cet égard. On y va souvent au plus facile : ajouter un discours paratextuel, l’énoncer dans la critique, l’évoquer en entrevue… autant de stratégies imparfaites mais nécessaires pour les œuvres contemporaines.
L’idéal moderniste de l’art exigeait que les œuvres soient autonomes, décontextualisables. On disait qu’une œuvre devait parler par elle-même, qu’elle ne devait pas avoir besoin d’explications. L’œuvre devait pouvoir se détacher de la pensée de l’artiste et sortir de son atelier sans qu’elle en soit altérée significativement. Aujourd’hui, au contraire, les gens aiment comprendre et accueillent les œuvres « accompagnées » sans sourciller. Si on est parfois impatient avec les textes d’accompagnement dans les musées, ce n’est pas par refus de réfléchir, mais plutôt parce que le texte en question n’est pas le meilleur véhicule pour la pensée de l’œuvre, ou encore que son propos ne porte pas sur ce qui nous questionne vraiment dans l’œuvre. Quoi qu’il en soit, on voit que la dimension esthétique ne suffit plus, la dimension épistémologique est aussi très importante. Je me demande d’ailleurs si la place prépondérante qu’on a accordée au concept d’esthétique dans les théories et les philosophies de l’art n’était pas une simple illusion. Je veux dire, l’esthétique a-t-elle jamais été la raison d’être de l’art? Je n’en suis pas sûre. Si je retourne dans l’histoire ou que je voyage dans les cultures du monde, je vois plutôt une fonction humaniste, existentielle. La contemplation esthétique – c’est-à-dire le plaisir sensoriel – fait sûrement partie de l’expérience que nous avons dans l’appréciation de l’art, mais elle ne m’apparaît pas centrale. Elle est plutôt inséparable d’une expérience d’ordre épistémique, humaniste, existentiel et surtout, surtout, relationnel.
Tant qu’on envisageait l’art principalement du point de vue esthétique, le contenu pouvait être conçu comme accessoire et relatif ; et effectivement, la forme semblait primer dans les expériences abstraites ou de musique pure. On disait alors que le contenu d’une œuvre comme Le marteau sans maître (1954) de Pierre Boulez ou Lavender Mist (1950) de Jackson Pollock était la musique elle-même dans le premier cas et la peinture elle-même dans le second. Je vois cela comme une phase. Car si toutes les œuvres de ce genre, qui ont ensemble parachevé la phase moderniste, ont révélé une sorte d’état absolu de l’art, rien ne s’est arrêté là. La fonction épistémique de l’art ne s’est jamais démentie et les expériences en ce sens se sont multipliées – jusqu’à ce qu’aujourd’hui, on en soit venu à considérer toutes les œuvres sous leurs angles conceptuels, contextuels (Ardenne, 2004) et relationnels (Bourriaud, 1998).
Le méta-art
En 1973, en pleine période conceptuelle donc, l’artiste américaine Adrian Piper publiait un article dans la revue Artforum, l’un des médias d’art les plus influents de l’époque (toujours publié aujourd’hui). Piper, cette même artiste qui a remporté en 2015 un Lion d’or à la Biennale de Venise, était alors âgée de 25 ans. Intitulé In Support of Meta-Art, son article appelait les artistes à révéler leur pensée et leurs contextes de création à l’intérieur, en filigrane ou en parallèle de leurs œuvres : ce qu’elle voulait appeler « méta-art ». Elle pensait que les conditions sociales, politiques, culturelles, mais aussi psychologiques et philosophiques dans lesquelles les œuvres sont créées sont importantes dans leur interprétation. Préfigurant les grands axes de la Cultural Theory qui balaierait tout le monde universitaire dans les années 1980 et 1990, elle refusait à l’art ses prétentions à l’universalité et au détachement idéologique. Son article ne générera pas le mouvement espéré d’écriture par les artistes, mais l’article lui-même reste symptomatique d’un courant de réflexivité qui a traversé l’art du 20e siècle et dont procède aussi la recherche-création. D’une certaine façon, la prémisse est la même, à savoir que les intentions et les contextes de création font partie intégrante de l’œuvre et qu’un récepteur qui veut comprendre l’œuvre va vouloir s’y intéresser. La réflexivité est l’une des grandes caractéristiques du temps présent – cette espèce de post-postmodernisme dont on cherche encore le nom – et celle-ci se joue dans les œuvres d’art, lesquelles ne sont plus définies comme des objets esthétiques, mais comme des objets à comprendre et à méditer.
Ainsi il y a quelque chose d’autre qui se joue dans la recherche-création que la simple production théorique de type universitaire. La thèse classique n’est qu’un début. Si l’on est d’accord que les aspects conceptuels, intellectuels, épistémiques ont pris de l’importance dans les œuvres contemporaines (et comment le nier?), alors on ne peut voir ceux-ci que comme partie intégrante de la création et leur explicitation comme partie intégrante du défi créateur. Puisqu’on est toujours dans l’œuvre elle-même, alors cette dimension « méta » de l’œuvre est une nouvelle habileté à maîtriser et un nouvel axe d’exploration dans la création. C’est pour cette raison que j’insiste sur une recherche-création faite en première personne, par l’artiste, que je différencie des recherches sur l’art, plus classiques, plus fidèles aux injonctions scientifiques, conduites par des spécialistes de l’art ((On dira alors « recherche en troisième personne ». Cette recherche sur l’art, que j’ai qualifiée d’in vitro dans un texte précédent, n’est pas visée par les considérations que je développe dans cette série de textes.)). On a déjà les signes d’une création réflexive (car c’est de cela qu’il s’agit dans la recherche-création en première personne) dans la production contemporaine et dans les attentes du public qu’on lui donne accès à cette réflexion.
Il n’est pas question de demander à l’artiste d’éclaircir les dimensions esthétiques de ses œuvres ou de produire un nuage herméneutique autour d’elles, mais plutôt de déployer les dimensions de compréhension et de sens dont l’œuvre est le médiateur. La question méthodologique prend ici une intensité toute particulière : en effet, sous quelles formes réaliser cela? Comment bien le faire? Que cette question se pose dans les études supérieures en art, que l’exploration des discours et des sens de l’œuvre fasse partie de l’éducation de l’artiste, cela n’est finalement ni surprenant, ni anodin.
La contribution humaniste de l’art
Adrian Piper voyait le témoignage de l’artiste sur son œuvre comme une contribution importante dont la société a besoin. Il s’agissait là, pour elle, d’un témoignage unique sur l’expérience artistique, d’une part, et sur la société au sein de laquelle la pratique de l’artiste est inscrite, d’autre part. Elle en faisait une question politique, mais on peut aller beaucoup plus loin, pour dire que c’est un témoignage unique sur la nature humaine elle-même : la création et l’imaginaire sont essentiels, en effet, à l’émergence même de l’esprit humain et tout ce qui s’y rapporte nous concerne profondément. Au-delà de l’œuvre à proprement parler, comme en orbite dans ses hautes sphères herméneutiques, se joue une vision de l’humain, de son intériorité, de sa relationalité, dont nous avons besoin, individuellement et collectivement, pour nous situer, pour nous développer. Pour instaurer (c’était là tout mon propos dans la présente série d’articles) les signifiances par lesquelles nous nous reconnaissons et nous nous approfondissons existentiellement. Les discussions sur l’art – et en particulier ce que l’artiste écrira de son expérience créatrice – sont d’un grand intérêt existentiel et humaniste et le public ne s’y trompe pas.
C’est ici que se fait le véritable lien entre l’art et la philosophie, selon moi. Non pas un art qui (comme le pensait Hegel) se consume dans le feu philosophique, ni un art qui va (comme l’a pensé Kosuth) incapaciter la philosophie, mais un art en tant que philosophie. C’est la logique du temps présent dans le monde de l’art, c’est aussi la logique derrière les travaux de recherche-création effectués par les artistes universitaires. Le modèle actuel de recherche-création, qui s’actualise dans les thèses et les articles universitaires, est un précurseur. Je ne dis pas que ces thèses sont susceptibles d’intéresser un large public. Pas encore. Mais elles explorent et expérimentent quelque chose qui a de l’avenir.
La dimension instaurative
L’œuvre contemporaine n’est pas un texte, c’est un lieu d’intelligence – de cette intelligence sensible et spirituelle (au sens large) qui appartient à l’expérience. Je crois que les humains font de l’art pour se donner des expériences qui transcendent la sphère limitée de la réalité ordinaire. Et ne nous y trompons pas, c’est parce que nous sommes capables de cette transcendance que nous avons pu évoluer : transcender l’immédiat et le visible, pour aller derrière, au-delà, autant dans les espaces que les temps de l’imaginaire. La mise en œuvre de l’imaginaire (imaginer l’autre, imaginer le futur, imaginer le possible et l’impossible, imaginer le sens…) est la fonction millénaire des arts et des littératures, personnellement je n’en vois pas d’autres. C’est ce que j’ai appelé la fonction instauratrice. Les œuvres d’art ouvrent ces dimensions expérientielles et la recherche-création nous permet de les penser et d’en parler entre nous.
Contrairement à la recherche sur l’art qui observe à distance l’œuvre et la création, cette recherche-création en première personne dont j’ai parlé s’inscrit dans la continuité de l’œuvre sur laquelle elle porte : elle a la même fonction et le même pouvoir instaurateur qu’elle – avec en plus le pouvoir de la réflexion. Elle pourrait donc avoir la même audace, la même inventivité… Être, avec la rigueur et la finesse qu’on attendra d’elle, une forme littéraire à part entière, pourquoi pas?
Bibliographie
ARDENNE, Paul, Un art contextuel, Paris, Flammarion, 2004.
BOURRIAUD, Nicolas, Esthétique relationnelle, Dijon, Les Presses du réel, 1998.
DANTO, Arthur, La transfiguration du banal, Paris, Seuil, 1989.
FOUCAULT, Michel, Dits et écrits : 1954-1988, t. IV (1980-1988), Paris, Gallimard, 1994.
KOSUTH, Joseph, Art After Philosophy and After : Collected writings, 1966-1990, Cambridge, MA : The MIT Press, 1991.
PIERRE, Schallum, « Hegel, l’art et le problème de la manifestation : l’esthétique en question », Phares, vol. 11, hiver 2011, p. 27-51
PIPER, Adrian, « In Support of Meta-Art », Artforum 12, no 2 (octobre 1973), p. 79–81. Repris dans Out of Order Out of Sight, vol 1 : Selected Writings in Meta-Art, 1968-1992, Cambridge, MA : The MIT Press, 1996, p. 17-27.