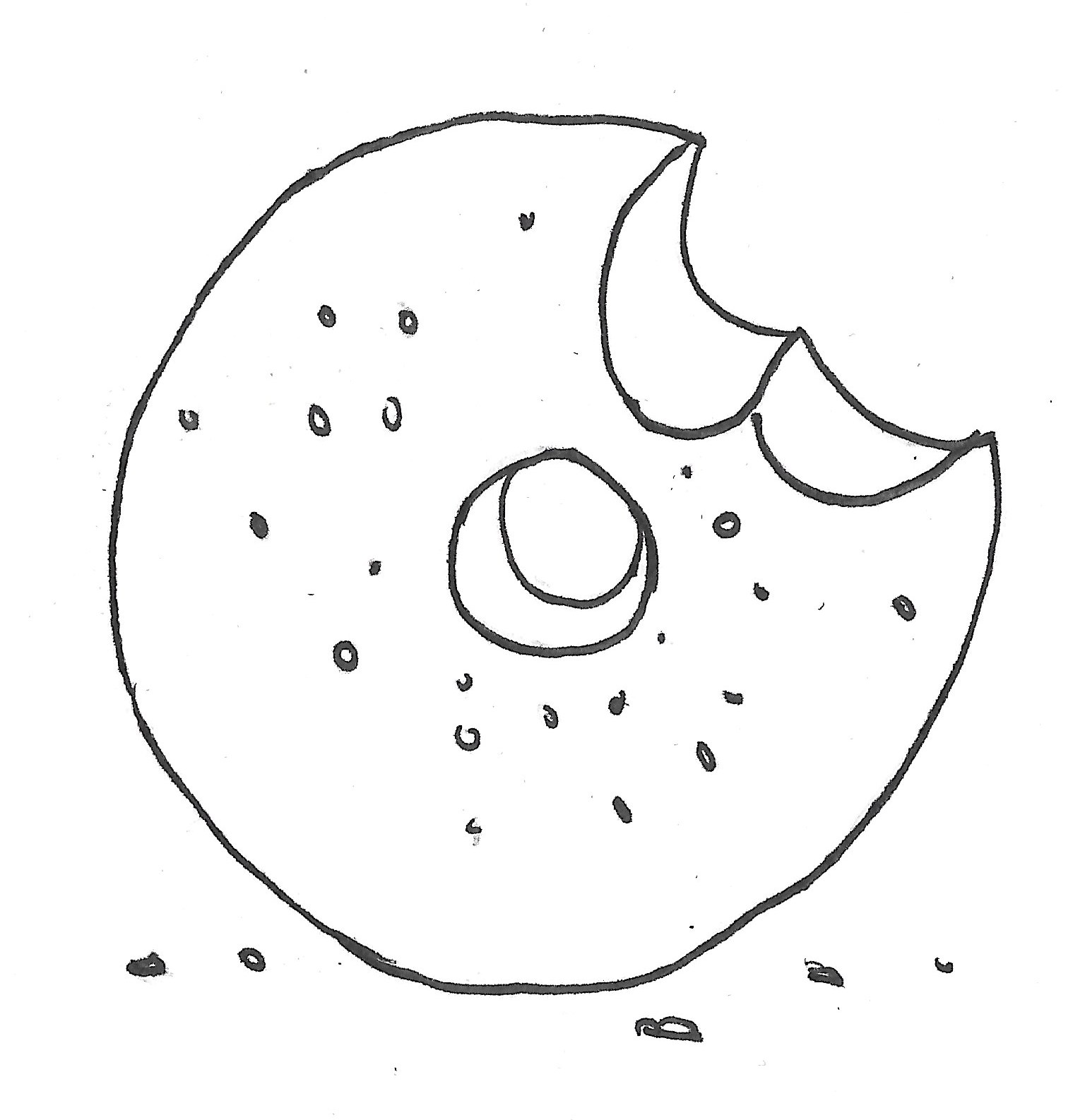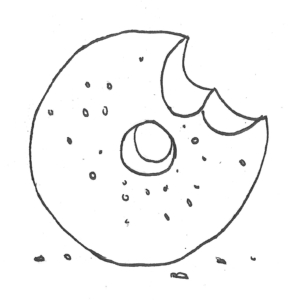Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j’ai passé Putain à ma psy. Elle n’avait jamais lu Nelly Arcan.
La semaine qui suit, Nelly est retrouvée suicidée.
Au rendez-vous, la psy m’accueille avec son visage désemparé. Elle me remet le livre gondolé par l’eau de sa baignoire ou de ses larmes.
Pour la première fois, nous ne parlons ni de mon poids ni de mes peurs. Nous ne parlons pas de moi. On parle de Nelly, seulement d’elle et de sa disparition, dans cette fin d’après-midi où nos voix s’enveloppent d’un étrange écho. Nous ne sommes pas seules. Un spectre, assis avec nous dans la chaleur du cabinet, se demande qui l’interpelle ainsi.
La psy me sonde. Je le pressens dans son regard qui m’ausculte, qui tente de mesurer l’empreinte de cette mort sur ma conscience, de crainte qu’une muse morbide n’y soit née. Je comprends que je dois sortir une phrase, concrète, qui désamorcera l’inquiétude qui la tiraille. C’est à mon tour de la rassurer. Plutôt, mes mains possédées plongent contre mon gré dans mon sac, extirpent mon carnet, le lui tendent.
Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je sais qu’il faut qu’elle me lise. Même si je le regrette aussitôt.
– Pourquoi tu pleures?
Tandis que j’amorce une réponse, les larmes prennent le relais, s’imposent comme chaque fois que le soulagement s’approche trop près de la douleur. L’heure dépassée depuis longtemps, je sors du cabinet, libérée d’un poids dont je ne soupçonnais même pas la présence.
Je rejoins mon père qui m’attend devant l’aquarium du hall d’entrée. Qui contemple avec fascination le ballet tranquille des poissons-clowns. La vision me secoue d’un grand rire. Je ris, je pleure, je ne ressemble plus à rien.
On rentre directement à la maison. Pas de bagels cette fois – mon père oublie.