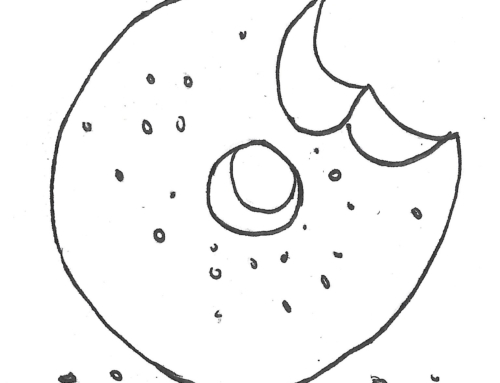Été. Basse-ville de Québec.
Le temps a changé juste après la tombée de la nuit. On a entendu un long roulement de tonnerre. Le ciel s’est déchiré et la pluie s’est abattue comme s’il n’y aurait pas de lendemain. Ça a claqué et grondé encore, plusieurs flashs de lumière ont explosé dans le ciel noir, puis c’est tombé en torrent pendant de longues minutes et au moment où la pluie semblait se calmer, ça a tonné encore et recommencé. Jusqu’au matin, par à-coups, la météo s’est affolée.
Fred était agité à cause des éclairs et du tonnerre. J’ai fini par fermer les fenêtres, pour le rassurer, malgré la chaleur qui persistait dans l’appartement. L’air est demeuré lourd jusqu’au matin, tendu, comme si la pluie drue ne suffisait pas à rétablir la pression atmosphérique. Vers le milieu de la nuit, j’ai entendu une forte détonation, et le lampadaire du coin de la rue s’est éteint, de même que le cadran de ma cuisinière et le ronronnement du frigo. La nuit est alors devenue encore plus noire, ponctuée seulement par les éclairs.
J’ai dormi un peu, blottie dans un grand fauteuil placé devant la fenêtre. Entre deux sommes, j’ai aperçu dans la cour, au-dessus des voitures, de longues silhouettes blanches qui valsaient. J’avais oublié les draps sur la corde à linge. Je les ai abandonnés à l’orage. Une main dans la fourrure de mon chien-ours, le front appuyé à la vitre, je les ai regardés, trempés, se débattre avec les bourrasques, virer dans tous les sens, s’enrouler autour de la corde, se déprendre et puis recommencer. Le vent les a emportés, à la fin. Je me suis dit, bon débarra. Malgré les lavages successifs, j’avais le sentiment qu’il était resté sur ces draps l’odeur fantôme de ma dernière peine d’amour, de la même manière que les personnes amputées sentent encore parfois de la douleur là où il n’y a plus rien.
Le jour a fini par se lever. Il pleuvait encore un peu, mais en gouttelettes fines, sans conviction. Fred m’a rappelé qu’il fallait aller marcher, lendemain de déluge ou pas, nuit blanche ou pas. Nous avons croisé Robert, notre voisin de balcon, qui montait l’escalier après être allé chercher son journal en bas, dans la boîte aux lettres. Il a dit que je n’aurais sûrement pas besoin d’arroser mes tomates, avec un sourire en coin. Des flaques d’eau s’étaient formées dans les nids-de-poule et la boue avait envahi le sentier de terre qui traversait le parc Roger Lemelin, que nous avons quand même emprunté pour atteindre la côte de la Pente-Douce. La basse-ville sentait mauvais – un mélange d’égouts trop pleins et de fumées industrielles restées coincées sous les nuages. Fred ne s’en souciait pas. Le museau au ras du sol, il reniflait avec ardeur les poteaux de téléphone, les poubelles et les clôtures. Les odeurs qui, pour moi, se fondaient toutes ensemble et saturaient l’air d’un parfum désagréable, racontaient pour Fred chacune une histoire. Notre promenade était une sorte d’enquête dans laquelle je suivais le détective excité sans comprendre moi-même la piste.
Et qu’importe la boue sur nos pieds.