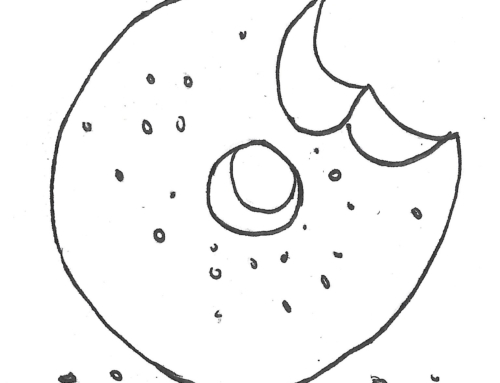« la femme […] leva vers moi le visage pour me suivre d’un long regard perplexe et suppliant que je n’ai cessé de revoir et qui n’a cessé, pendant des années, jusqu’à ce que j’obtempère, de me demander ce que tous nous demandions peut-être du fond de notre silence : Raconte ma vie. »
Gabrielle Roy, Un jardin au bout du monde
Un taxi m’a déposée au 2120, rue Augustin-Cantin, où j’allais rencontrer la sœur de mon père, hébergée dans un Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) situé entre Griffintown et Pointe-Sant-Charles à Montréal. Cette visite, ce n’était ni une obligation ni un passage obligé, mais un choix, une obsession. Pour une parfaite inconnue, âgée de 92 ans, qui est de mon sang, pourtant.
1948, année de la publication du manifeste Refus global, elle a fui sa campagne natale, en compagnie d’un chauffeur de taxi, un type, pas très recommandable. Aujourd’hui, plus personne ne se souvient d’elle, de son histoire scandaleuse d’une époque qui n’est plus la nôtre ; où au nom de la morale et de la défense des bonnes mœurs, les bien-pensants l’ont contrainte à couper les ponts avec les siens. Seule, isolée, abandonnée, appauvrie, confuse et diminuée sur le plan neurocognitif, elle termine ses jours dans le silence et l’oubli. Raconter la vie de cette femme fascinante, et aussi des individus qui habitent ces lieux, souvent qualifiés de mouroirs, est devenu une idée fixe.
*****
À l’été 2022, un CHSLD de la Rive-Sud de Québec m’a invitée, à titre de travailleuse sociale, à me joindre à une équipe de professionnels en soin de santé. On me proposait de réaliser des évaluations psychosociales de personnes en situation de vulnérabilité dans le cadre de l’homologation d’un mandat de protection ou d’une demande d’ouverture d’une tutelle au Curateur public du Québec. Avec le recul, je suis un peu surprise d’avoir accepté aussi spontanément cette offre d’emploi. Les conditions de vie déplorables des personnes âgées vivant dans ces centres avaient fait l’objet de nombreux reportages à la télévision et dans les journaux durant la pandémie, alors pourquoi avais-je accepté aussi rapidement de travailler dans ces milieux miséreux ? De pratiquer cette profession difficile que j’avais boudée pendant toute ma carrière dans la fonction publique ? J’avais sans doute un sentiment de culpabilité, quelque chose à me faire pardonner, peut-être ma situation de femme blanche retraitée et privilégiée, mais pas au point de justifier un engagement dans un CHSLD ! Il me suffisait, il me semble, pour me détourner de ce projet inconfortable, de relire la description de Pierre Lefebvre dans son livre Le virus et la proie :
Et si ma mère est aujourd’hui dépouillée de son humanité, si le cauchemar ordinaire de ses dernières années, l’égrainement monotone de ses mois, de ses jours, de ses heures, […] s’avère pour elle d’une pauvreté, d’une platitude accablante ne pouvant pas se terminer par autre chose qu’une mort pathétique, sordide sans doute, au beau milieu des autres résidents de la place qui râlent, qui ronflent, qui bavent, qui hurlent en attendant leur tour, c’est quand même à cause de ce que c’est, un CHSLD[1].
La vérité, cela peut paraître absurde aux yeux du monde ordinaire, c’est que je m’obstine à voir, dans cette résidence nichée sur son promontoire, exposée aux grands vents, en bordure du fleuve Saint-Laurent, non pas des grabataires, des patients en fin de vie, mais des êtres humains vivants, passionnants, vibrants, qui dégagent un je-ne-sais-quoi. Quelque chose qui ressemble à « cet étonnement de vivre » que l’on retrouve dans les romans et les récits de Gabrielle Roy.
En arpentant les longs corridors de l’établissement, j’ai le sentiment un peu étrange que les résidents me regardent de ce « long regard perplexe et suppliant » et me demandent d’écrire le récit qui ferait d’eux un personnage unique, un souvenir puissant, qui les mettrait à l’abri de l’oubli. J’ai l’impression que cette idée fixe ne me quittera plus, comme Gabrielle Roy, jusqu’à ce que « j’obtempère. » Toutefois, prétendre que mon projet d’écriture se justifie seulement et uniquement pour répondre à une demande suppliante de personnes en quête d’auteure, ce serait me mentir à moi-même. Ce serait faire fi de la satisfaction personnelle et professionnelle associée à l’écriture.
Yvon Rivard, dans Une idée simple, propose une judicieuse réflexion sur cette question : « toute cette histoire de roman qui répond à la demande muette des êtres muets, démunis est un subterfuge pour justifier une activité socialement et spirituellement inutile ou qui ne sert que l’auteur et peut-être ses lecteurs[2]. »
Néanmoins, malgré le plaisir de l’autrice, et peut-être un jour celui des lecteurs et des lectrices (du moins je l’espère), je ressens un désir profond et sincère, un réel besoin de m’engager dans une entreprise plus grande que mon existence « au pays de la vie ordinaire[3]. » Accompagner ces femmes et ces hommes nés pour la plupart avant la Seconde Guerre mondiale, souvent de parents modestes plus ou moins analphabètes dans des maisons sans livres, demeure un privilège. Des gens qui ont trimé dur pour s’élever et créer de meilleures conditions de vie pour eux-mêmes et le reste de la population. Un grand nombre de ces personnes ont grandi durant la Grande Noirceur, ont connu la décléricalisation des études, la Révolution tranquille. Grâce à eux, des réformes importantes ont été menées pour que la société québécoise puisse rattraper l’écart avec les économies mondiales et assurer la modernisation de l’État. Pourquoi s’intéresse-t-on si peu à leur existence, à leur contribution exceptionnelle aux changements sociaux, culturels et économiques ? Peut-être cela vient-il d’un réflexe d’évitement ou de la peur de vieillir, « de contempler la mort[4] », suggère Martine Béland dans Mégaptère, ainsi que Mathieu Bélisle dans Ce qui meurt en nous : « la crise révélait des failles profondes non seulement dans notre manière de prendre en charge la santé et la maladie, mais dans notre rapport à la vieillesse et à la mort[5]. »
Toutes les semaines, je côtoie les signes de la vieillesse et de la mort, les odeurs, les corps décharnés, les visages émaciés, les gestes hésitants. Est-ce la crainte de vieillir et de mourir qui exige qu’on passe à autre chose le plus vite possible, qu’on efface de notre pensée les traces des personnes malades, qu’on les ignore, pressé de se réfugier dans le traintrain quotidien ? Mathieu Bélisle se demande si la vie, au-delà d’un certain âge, a moins de valeur et d’intérêt. Comme si à quatre-vingts ans, quatre-vingt-quinze ans, il n’y avait plus de joie de vivre, d’espoirs, de rêves, de projets. Comme si plus personne ne se souciait de ce que ces aînés ont vécu, de ce qu’ils attendent, peut-être, encore de la vie. Pourtant, ils méritent qu’on parle d’eux dans l’espace public autrement qu’en termes de chiffres, de statistiques, de tableaux, de courbes et de listes d’attente.
L’écriture est ce chemin que je choisis d’emprunter pour tenter de comprendre le monde et donner un sens à mes réflexions, à mes actions. Ainsi que l’écrit Yvon Rivard : « Aider, porter assistance à autrui, se soucier de la réalité de l’être et du bonheur des hommes, telles sont aujourd’hui, à ses yeux, la vocation ultime et l’unique justification de l’art, de la littérature, de la pensée[6]. »
*****
Je dois me rendre à l’évidence : la sœur de mon père ne sait pas qui je suis. Elle cherche dans mes yeux une raison, une explication à ma présence étrange. Elle fouille sans succès dans un recoin perdu de son cerveau à la recherche d’une trace de mon existence. En vain, les mots meurent quelque part où je n’ai pas accès. Il ne reste que le regard : un regard intense qui me rappelle celui de mon père décédé. Un regard qui cherche la lumière éteinte des souvenirs obscurs. Un regard qui évoque de vagues moments de mon enfance, des chuchotements, des murmures, des sous-entendus, des bribes de conversations échangées à voix basse par des adultes.
[1] Lefebvre, Pierre, Le virus et la proie, Montréal, Éditions Écosociété, 2022, p. 42.
[2] Rivard, Yvon, Une idée simple, Montréal, Les Éditions du Boréal, « coll. Papiers collés », 2010, p. 142.
[3] Bélisle, Mathieu, Bienvenue au pays de la vie ordinaire, Montréal, Leméac, Éditeur, coll. « Nomades », 2017, p. 9.
[4] Béland, Martine, Mégaptère, Montréal, Leméac Éditeur, coll. « L’inconvénient », 2023, p. 74.
[5] Bélisle, Mathieu, Ce qui meurt en nous, Montréal, Leméac Éditeur, 2022, p. 19.
[6] Rivard, Yvon, Une idée simple, Montréal, Les Éditions du Boréal, coll. « Papiers collés », 2010, p. 9.