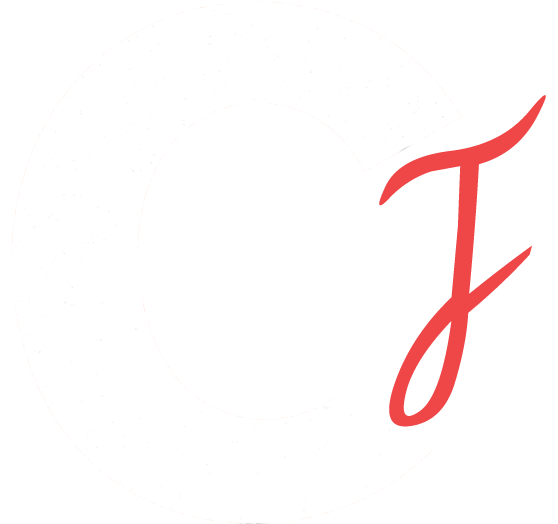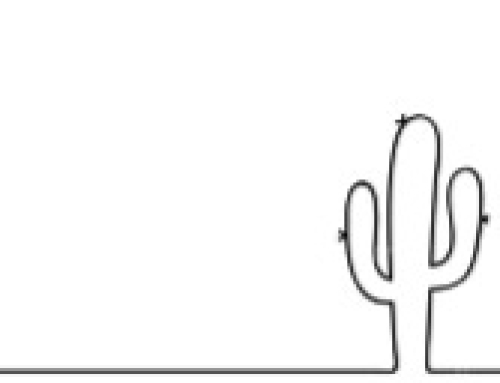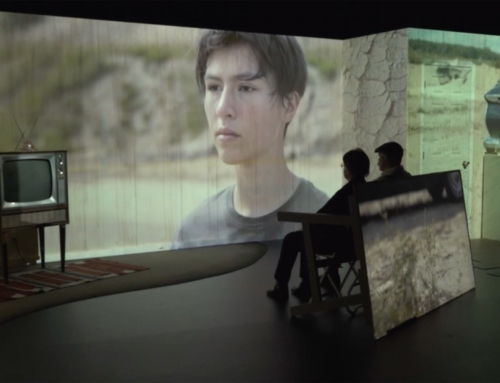*L’emploi du féminin dans ce texte a pour seul objectif de faciliter la lecture et inclut toutes les personnes, sans distinction de genre.
Dans ma recherche doctorale, j’examine le rôle de l’empathie[1] en éthique, notamment dans les questions de justice sociale et de démocratie, et comment la création littéraire[2] peut contribuer à cultiver des capacités empathiques. Le point central de cet article porte sur ce deuxième thème.
Mon approche combine des essais d’autrices sur leur expérience d’écriture, des entretiens avec des écrivaines analysés dans une perspective phénoménologique, des études empiriques en sciences cognitives et des réflexions issues des théories littéraires. Ce cheminement m’a conduit à formuler deux hypothèses principales.
D’une part, je soutiens que l’écriture possède un potentiel supérieur à celui de la lecture pour cultiver l’empathie. Pour appuyer cette idée, je nourris ma réflexion d’études empiriques sur les expériences de lecture ainsi que sur les témoignages d’écrivaines relatant leur propre pratique d’écriture. D’autre part, je propose des suggestions pour une pratique que je nomme écriture empathique, en expliquant pourquoi ces approches pourraient susciter de l’empathie par l’écriture. Cette notion d’écriture empathique s’inspire de la lecture empathique développée par Pierre-Louis Patoine, des recherches empiriques sur les éléments textuels générateurs d’empathie en lecture, ainsi que des témoignages d’autrices sur leur expérience créative.
Les recherches empiriques sur la relation entre la lecture, en particulier de fictions, et l’empathie se développent rapidement. Certaines études examinent comment la lecture suscite des réponses empathiques, tandis que d’autres analysent les caractéristiques textuelles qui amplifient les capacités empathiques des lecteurs. Ces travaux se concentrent toutefois majoritairement sur la lecture, bien plus que sur la création littéraire. À l’exception des recherches en médecine narrative (voir Charon, 2017, chapitres 5 et 6) et de l’« écriture réflexive » (de l’anglais reflective writing), il existe peu d’études empiriques sur le potentiel de la création littéraire à développer l’empathie (voir Kou et al., 2020). Par ailleurs, certains psychologues se sont penchés sur les traits de personnalité des écrivain·e·s, notamment en lien avec leur aptitude à créer des personnages captivants (Djikic, Oatley et Peterson, 2006). La question reste donc largement ouverte : l’écriture peut-elle réellement renforcer l’empathie, et si oui, comment ?
Distance esthétique et transport : entre lecture et écriture
Selon les recherches empiriques, deux éléments peuvent influencer nos capacités empathiques lors de la lecture : la distance esthétique (ou immobilité) et le niveau de transport (également appelé absorption ou immersion).
Concernant le concept de distance esthétique, Koopman et Hakemulder le décrivent comme « une attitude de détachement permettant à la contemplation de se déployer »[3] (2015 : 80). Ils ajoutent :
En ce qui concerne le transport et son impact sur l’empathie, l’étude la plus célèbre à ce sujet a été réalisée par Bal et Veltkamp (2013). Ces chercheurs ont examiné si le niveau d’immersion émotionnelle dans une histoire pouvait améliorer l’empathie des lecteurs, tout en explorant l’influence de la fictionnalité sur les réponses empathiques. L’étude a invité les participantes à lire des œuvres de fiction, telles que Les Six Napoléons d’Arthur Conan Doyle, mettant en scène Sherlock Holmes, ou Cécité de José Saramago, et à comparer leurs effets sur l’empathie avec ceux de lectures de non-fiction, comme des articles de journaux. Les auteurs soutiennent que la fiction doit non seulement captiver, mais également être plausible pour favoriser l’immersion :
Les résultats montrent que « les lecteurs fortement transportés par la lecture de Sherlock Holmes ont vu leur empathie augmenter, tandis que les lecteurs peu transportés, que ce soit avec Doyle ou Saramago, ont vu leur empathie diminuer » (Bal et Veltkamp, 2013 : 8). De plus, les réponses empathiques des lecteurs augmentent une semaine après la lecture de fiction et sont proportionnelles au niveau de transport, ce dernier étant généralement plus élevé pour les œuvres de fiction que pour la non-fiction.
Abordons maintenant les expériences liées à l’écriture. En l’absence d’une théorie unifiée de la psychologie de la création littéraire, ma réflexion s’appuie sur le modèle élaboré par la psychologue Charlotte L. Doyle (1998). Ce modèle, basé sur des entretiens approfondis avec cinq écrivains, propose une théorisation du processus d’écriture à partir de leurs expériences.
Selon ce modèle, après ce qu’elle appelle l’incident déclencheur (seed incident en anglais) un événement qui donne à l’écrivaine l’impulsion d’écrire, cette dernière doit créer une distance entre elle-même et le monde, elle doit trouver un lieu qui permette « une certaine manière d’être », un « retrait du tumulte de la vie quotidienne. Les lieux devaient être solitaires, parce que la fiction est « le genre d’écriture que vous faites dans une pièce tout seul » » (Doyle, 1998 : 31). Doyle appelle cet endroit le domaine de l’écriture (writingrealm en anglais), décrit « comme le monde du jeu de l’enfant, le monde des fous, mais aussi le monde des rêves, de l’art, le monde de la contemplation scientifique » (1998 : 31). En écho à cette idée, Élise Turcotte dit « j’ai toujours été portée à regarder ailleurs pour arriver à écrire. J’ai besoin de cette distraction, qui n’est pas le contraire de la concentration – elle est son complément. Je me concentre sur ce que je fais, et puis je dévie » (2017 : 56). Une fois que l’écrivaine a atteint cette dimension où les perceptions du monde externe sont amorties, elle peut alors plonger dans ce que Doyle identifie comme un « mode d’expérience » qu’elle appelle le monde de la fiction (fictionworld en anglais): « un monde en évolution peuplé de personnages et d’événements tels qu’ils apparaissent dans l’expérience imaginative et les mots de l’auteur » (1998 : 35). Dans cette phase, les écrivaines sont moins conscientes de leur singularité, leur sens de soi semble être moins présent, « dans le monde de la fiction, le moi d’écriture conscient de lui-même disparaît (Csíkszentmihályi 1990; 1996) » (Doyle 1998 : 34).
Ce modèle de la création littéraire proposé par Doyle trouve des correspondances dans les expériences de création décrites par les auteur·ice·s. Nicholson Baker décrit le domaine de l’écriture par la privation sensorielle : « j’ai toujours trouvé que la privation sensorielle m’aidait. Avant, je portais souvent des bouchons d’oreilles. Parfois, j’écrivais les yeux fermés … On pense différemment quand on ne peut pas voir » (Anderson/Baker 2011 : 42). De façon similaire, Jeffrey Eugenides déclare : « la composition proprement dite, je ne veux pas la faire dans un espace agréable. Je pense même à m’installer dans le grenier parce que c’est l’endroit le plus austère et isolé de la maison » (Gibbons/Eugenides 2011 : 122). Henry James affirme que la seule chose qui compte est « vivre dans le monde de la création – y entrer et y rester – le fréquenter et le hanter – penser avec intensité et de manière féconde – susciter des combinaisons et des inspirations par la profondeur et la continuité de l’attention et de la méditation » (Terzian/Hollinghurst, 2011: 61). Cela fait écho à la nature du monde de la fiction ainsi appelé par Doyle, et que Nicholson Baker décrit ainsi : « C’était totalement captivant, la sensation d’être plongé au milieu d’un grand étang chaud, presque incontrôlable » (Anderson/Baker 2011 : 29).
De ces témoignages et de la théorie du modèle de Doyle, il en suit que le domaine de l’écriture est caractérisé par une prise de distance, alors que le monde de la fiction est une expérience immersive caractérisée par un sens de soi qui s’estompe. Ces deux dynamiques – la distance esthétique et le transport – influencent l’empathie lors de la lecture, et il est plausible qu’elles jouent un rôle similaire dans l’écriture. Ce qui distingue l’écriture, c’est que ces états semblent indispensables à sa pratique, ce qui suggère qu’elle pourrait être un vecteur encore plus influent pour développer l’empathie que la lecture. Ce propos suscite un questionnement supplémentaire, à savoir s’il est possible de véritablement lire sans être captivé par un récit, faisant ainsi écho à Turcotte qui affirme : « Je ne peux lire que si je suis envoutée » (2017 : 164).
Écrire en changeant de « point de sentir »
Si on revient au monde de la fiction, Doyle le décrit comme « un monde en évolution peuplé de personnages et d’événements tels qu’ils apparaissent dans l’expérience imaginative et les mots de l’auteur » (1998 : 33). Or, un trait particulier de cette expérience est l’apparition des personnages qui, parfois: « assument leur propre réalité » (Doyle, 1998 : 33) et les autrices vivent « leurs personnages avec tous leurs sens – les entendant, les sentant même parfois » (Doyle, 1998 : 33). Ainsi, certaines autrices entretiennent une relation parasociale avec leurs personnages, qui miroite les modalités relationnelles avec autrui dans la vraie vie, tandis que d’autres ont « l’impression d’être leurs personnages » (Doyle, 1998 : 33), simulant leurs divers points de vue.
Mes hypothèses à propos de l’écriture empathique s’inspirent de la lecture empathique de Pierre-Louis Patoine, qui définit cette dernière comme une réaction physique à l’artefact littéraire : « ressentir, en lisant, le jeu musculaire de corps en lutte ou la douleur physique d’un personnage blessé : voilà ce qu’est la lecture empathique » (2015 : n.p.). La question qu’il se pose et qui m’intéresse le plus est « comment un texte littéraire peut-il créer un langage de la sensation qui sollicite le corps physiologique de son lecteur? » (Patoine, 2015 : n.p.)
Dans Corps/Texte (2015), Patoine analyse quatre romans sensationnalistes américains pour identifier les variables influençant les réactions somesthésiques chez les lectrices. Parmi ces œuvres, deux se distinguent par leur capacité à susciter une lecture empathique. L’un d’eux, A Million Little Pieces de James Frey, plonge le lecteur dans un flux de conscience si convaincant qu’il semble réel, permettant de partager les douleurs extrêmes du personnage. Frey dépeint notamment une opération dentaire en modifiant la prosodie et en créant une communion vocale entre la voix narratrice et la voix intérieure de la lectrice. À ce sujet, Patoine observe que : « les phrases répétitives et sans ponctuation de la scène du dentiste traduisent bien la continuité du courant de conscience dans lequel le narrateur nous maintient » (2015 : n.p.). Ce récit émerge directement du corps : au lieu d’avoir mal pour le personnage, le lecteur souffre avec lui, se détachant de son propre point de sentir pour vivre les sensations du personnage. Cette notion du changement de point de sentir, introduite par Patoine, est cruciale pour notre réflexion. En effet, en adoptant la formule du point de sentir plutôt que celle du point de vue, Patoine vise à décloisonner l’imagination du domaine de la vision. Il considère l’imagination comme haptique, englobant toutes les sensations possibles telles qu’elles sont potentiellement évoquées par le texte. Pour l’auteur, la lecture empathique est plus facile lorsque le lecteur embrasse le point de sentir de la voix narratrice, dans une sorte de simulation des expériences racontées dans le récit. C’est une sortie hors de soi, où le sujet résonant est décentré et va rejoindre les corps présentés par l’œuvre littéraire pour faire l’expérience de différents points de sentir.
Le deuxième exemple fourni par Patoine au sujet des expériences somesthésiques est la nouvelle de Palaniuk intitulée Guts, qui débute ainsi : « Inspirez. Prenez autant d’air que possible. Cette histoire devrait durer à peu près aussi longtemps que vous pouvez retenir votre souffle, et un tout petit peu plus longtemps. Alors, écoutez aussi vite que vous le pouvez » (tiré de Patoine, 2015: n.p.). Cette invitation génère une sensation de stress, de suffocation. Ainsi, selon Patoine, Palahniuk prime son lectorat au niveau physique. Patoine identifie d’autres escamotages employés par Palahniuk afin de susciter la lecture empathique – une vaste utilisation de verbes de mouvement et une « accumulation de détails gustatifs, olfactifs et tactiles, détails qui permettraient de susciter une sympathie physique » (2015 : n.p.), sortir du cérébral pour accéder au somatique.
Certaines expériences d’écrivaines semblent faire écho à la théorie de Patoine à propos d’un changement de point de sentir et d’un récit qui surgit du corps, sauf qu’elles parlent d’expériences faites à travers la pratique d’écriture. Bret Easton Ellis affirme d’écrire aussi pour ressentir ce que chaque personnage vit dans le livre (Goulian/Easton Ellis 2012: 178). Katherine Anne Porter témoigne aussi de la stimulation sensorielle propre à l’écriture, en affirmant: « Tous mes sens étaient très aiguisés – les choses me parvenaient par les yeux, par tous mes pores » (Davis/Porter, 1963 : 104). Nicholson Baker parle plus clairement d’un changement de point de sentir, d’une expérience incarnée, il dit notamment : « j’écrivais certaines des vignettes du point de vue d’une femme et d’autres du point de vue d’un homme… pour imaginer une femme dans une scène de sexe, pour raconter cette histoire moi-même, je dois devenir la femme pendant ce moment » (Anderson/Baker, 2011: 47). Un témoignage encore plus marquant sur l’expérience en première personne du vécu d’un personnage fictif est apporté par Deborah Eisenberg, qui déclare: « Bien sûr, il y a des avantages accessoires à écrire de la fiction. Vous pouvez, par exemple, quitter votre corps, ce qui vous permet d’avoir des expériences qu’une personne avec vos caractéristiques physiques ne pourrait pas réellement avoir » (Steindler/Eisenberg 2013 : 72). En conclusion, plusieurs écrivaines font l’expérience d’abandonner leur point de sentir, d’« enfiler pour essayer (trying on) d’autres personnes » (Wray/LeGuin, 2013 : 55) pour « les incarner de l’intérieur » (Simpson/Mantel 2012 : 55).
L’écriture empathique
Dans les études empiriques sur la littérature, les chercheuses ont identifié de multiples aspects du texte dont la présence est corrélée avec une majeure réponse empathique chez le lectorat. Certaines des hypothèses les plus importantes se concentrent sur les éléments de défamiliarisation (foregrounding en anglais : Scapin et al., 2023 ; Koopman, 2016 ; Hakemulder, 2020), la narrativité, la fictionnalité, la littérarité (Koopman et Hakemulder 2015) les marqueurs de point de vue (Eekhof et al. 2022) et la complexité des caractères (Maslej et al. 2020). Pour l’instant, il n’y a pas de preuves cohérentes et finales à propos de l’impact de ces caractéristiques textuelles sur l’empathie, en raison de toutes les variables que les études doivent prendre en compte et qui peuvent influencer le processus de lecture, entre autres. Néanmoins, les résultats disponibles ne sont pas décourageants, et d’autres études sont certainement nécessaires.
En m’inspirant de ces études sur le lien entre les éléments textuels et l’empathie, je propose un modèle d’écriture empathique qui pourra servir de point de départ à de futures recherches visant à évaluer son influence sur l’empathie générée par l’acte de création.
Tout d’abord, je considère que l’incident déclencheur présente des caractéristiques similaires aux éléments défamiliarisants[4]. Ainsi, je propose de commencer l’écriture à partir du souvenir d’un événement qui a laissé l’écrivaine interdite, confuse ou intriguée. Ensuite, j’invite à imaginer un personnage totalement fictif, en évitant de décrire quelqu’un de connu. Par ailleurs, il est important d’écrire de manière littéraire. À cette fin, on peut envisager de fournir des « dossiers de ressources » remplis de vidéos, de chapitres de livres, d’articles de blogues et d’articles académiques qui introduisent des façons d’écrire de manière créative. La quatrième suggestion est d’écrire au Je, dans un flux de conscience où la voix narratrice ne parait pas, ne se dévoile pas comme telle. En soutien à cette idée, Kaufman et Libby (2012) ont constaté que les récits à la première personne par rapport aux récits à la troisième personne augmentaient la prise d’expérience, qui est définie comme « simulant l’état d’esprit et la personnalité d’un protagoniste », l’état d’esprit étant constitué par « les pensées, les émotions, les objectifs, les traits et les actions du personnage et vivant le récit comme s’il était ce personnage » (2012 : 2). Enfin, il sera nécessaire d’enrichir la narration avec des éléments textuels qualifiés de « marqueurs de point de vue ». Je suggère enfin d’écrire en ajoutant des éléments textuels qui indiquent les pensées et les émotions du personnage avec une emphase sur les perceptions et les sensations corporelles du personnage qui s’exprime.
Conclusion
De nombreuses recherches actuelles mettent en avant le potentiel de la littérature, en particulier de la lecture, dans la sollicitation de l’empathie. Dans cet article, j’ai souhaité plutôt mettre l’accent sur l’activité de création littéraire et sur son potentiel accru, en comparaison avec la lecture, pour cultiver l’empathie.
Dans un premier temps, j’ai expliqué pourquoi l’acte même d’écrire peut être potentiellement plus fécond pour stimuler l’empathie, notamment parce qu’il exige à la fois une prise de distance par rapport au monde extérieur et un niveau d’immersion souvent liés à l’expérience empathique.
Dans un second temps, j’ai proposé des pistes d’écriture visant à construire des expériences empiriques et à vérifier si une pratique d’écriture pensée pour susciter l’empathie peut effectivement favoriser son développement.
L’idéal serait qu’à l’avenir, on puisse examiner si le fait d’écrire dans un style littéraire sur des personnages entièrement fictifs, en adoptant une perspective à la première personne sans l’expliciter dans le récit, et en intégrant des marqueurs textuels du point de vue cognitif, émotionnel et, surtout, perceptif, peut renforcer l’imagination empathique. Nous pourrions alors élaborer des parcours de formation cohérents avec ces incitations à l’écriture et redonner à l’acte d’écrire un rôle sociopolitique important.
Je remercie le professeur Frank Hakemulder pour sa collaboration et ses précieuses suggestions dans la formulation de certaines idées de cet article.
[1] Dans cet article, le terme empathie désigne l’ensemble de deux phénomènes : l’imagination empathique, qui nous porte à saisir le vécu, l’expérience d’autrui, et la préoccupation empathique comme étant une « émotion orientée vers autrui, suscitée par et congruente avec le bien-être perçu de quelqu’un dans le besoin » (Batson 2018, 29).
[2] Dans cet article, je définis la création littéraire comme les processus imaginatifs qui aboutissent à un récit écrit.
[3] Toutes les traductions des textes dont l’original est en anglais sont de l’auteure (MdS).
[4] Comme l’explique Hakemulder, le foregrounding est une déviation, un élément du texte qui a besoin de temps pour être traité, générant ainsi une suspension du jugement et de la réflexion. Il explore une étude de Koopman (2016) et identifie sept façons différentes de faire l’expérience des défamiliarisations propre au foregrounding, en tenant compte des réactions du lecteur aux éléments défamiliarisants dans le texte. Les participants à l’étude parlent d’une expérience de : 1) surprise ; 2) d’ambiguïté ; 3) symbolique ; 4) impressionniste ; 5) d’obstruction ou de « quelque chose qui entrave le processus de réception » (Hakemulder, 2020 : 102) ; 6) d’absorption, « accompagnée d’un sentiment de manque d’agentivité, et de tentatives de réguler à la baisse l’intensité de l’expérience » (Hakemulder, 2020 : 102) et enfin 7) d’« une force dans le texte qui pousse les lecteurs vers un engagement avec un personnage, une implication qui est vécue comme désagréable ou conflictuelle » (Hakemulder, 2020 : 102). En outre, les écrivains décrivent les incidents déclencheurs comme étant « touchants, intrigants, déroutants, mystérieux, obsédants ou accablants » (Doyle, 1998 : 30). À ce propos, les écrivains interviewés par Doyle ont d’ailleurs rapporté avoir été déconcertés par des événements qui « semblaient pleins de significations » (Doyle, 1998 : 30), qui étaient difficiles à saisir. Pour cette raison, je considère que les éléments de défamiliarisation dans le texte partagent des aspects phénoménologiques avec les incidents déclencheurs.
Bibliographie
ANDERSON, Sam et Nicholson BAKER, « The Art of Fiction No. 212 », dans The Paris Review, numéro 198, automne 2011, p. 24-55.
BAL, P. Matthijs et Martijn VELTKAMP, « How does fiction reading influence empathy? An experimental investigation on the role of emotional transportation », dans PloS one, numéro 8(1), 2013, e55341, p. 1-12.
BATSON, C. Daniel, A scientific search for altruism: Do we only care about ourselves?, Oxford University Press, 2018.
CHARON, Rita. The principles and practice of narrative medicine, Oxford University Press, 2017.
DJIKIC, Maja, OATLEY, Keith et Jordan B. PETERSON, « The bitter-sweet labor of emoting: The linguistic comparison of writers and physicists », dans Creativity research journal, numéro 18(2), 2006, p. 191-197.
DOYLE, L. Charlotte, « The writer tells: The creative process in the writing of literary fiction », dans Creativity Research Journal, numéro 11(1), 1998, p. 29-37.
EEKHOF, S. Lynn et al, « Reading minds, reading stories: Social-cognitive abilities affect the linguistic processing of narrative viewpoint », dans Frontiers in Psychology, numéro 12, 2021, 698986.
GIBBONS, James et Jeffrey EUGENIDES, « The Art of Fiction No.215 », dans The Paris Review, numéro 199, hiver 2011, p. 118-148.
GOULIAN, Jon-Jon et Bret EASTON ELLIS, « The Art of Fiction No. 216 », dans The Paris Review, numéro 200, printemps 2012, p. 169-196.
KAUFMAN, F. Geoff, et Lisa K. LIBBY, « Changing beliefs and behavior through experience-taking », dans Journal of personality and social psychology, numéro 103(1), 2012, p. 1-19.
KOOPMAN, Emy M. et Frank HAKEMULDER, « Effects of literature on empathy and self-reflection: A theoretical-empirical framework », dans Journal of Literary Theory, numéro 9(1), 2015, p. 79-111.
KOU, Xiaonan, KONRATH, Sara et Thalia R. GOLDSTEIN, « The relationship among different types of arts engagement, empathy, and prosocial behavior », dans Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, numéro 14(4), 2020, p. 481.
MASLEJ, Marta, OATLEY, Keith et Raymond A. MAR, A. « Creating fictional characters: The role of experience, personality, and social processes », dans Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, numéro 11(4), 2017, p. 487.
PATOINE, Pierre-Louis, Corps/texte. Pour une théorie de la lecture empathique: Cooper, Danielewski, Frey, Palahniuk, École Normale Supérieure, 2015.
SIMPSON, Mona et Hilary MANTEL, « The Art of Fiction No. 226 », dans The Paris Review, numéro 212, printemps 2015 p. 37-71.
STEINDLER, Catherine et Deborah EISENBERG, « The Art of Fiction No. 218 », dans The Paris Review, numéro 204, printemps 2013, p. 68-98.
TERZIAN, Peter et Alan HOLLINGHURST, « The Art of Fiction No. 214 », dans The Paris Review, numéro 199, hiver 2011, p. 35-68.
THOMPSON, Barbara et Katherine Anne PORTER, « The Art of Fiction No. 29 », dans The Paris Review, numéro 29, hiver-printemps 1963, p. 87-114.
TURCOTTE, Élise, Autobiographie de l’esprit: écrits sauvages et domestiques, La Mèche, 2017.
WRAY, John et Ursula K. LE GUIN, « The Art of Fiction No. 221 », dans The Paris Review, numéro 206, automne 2013, p. 49-76.