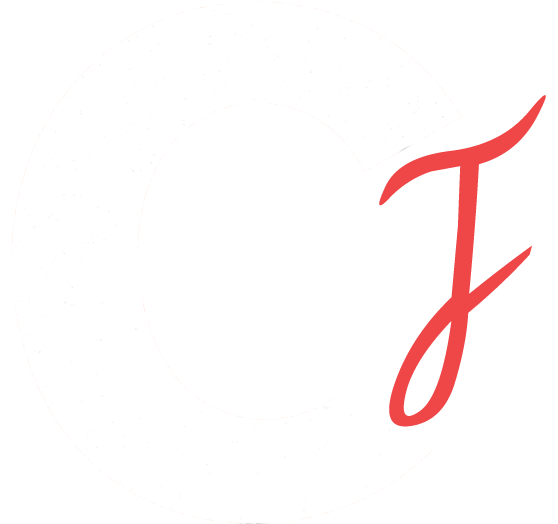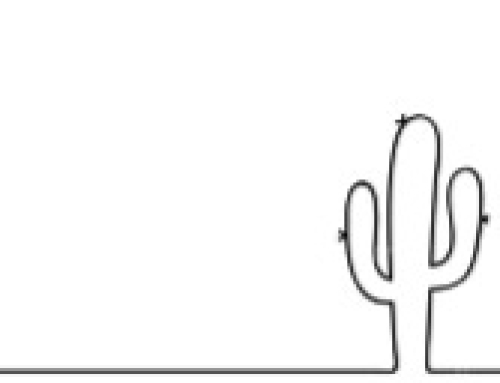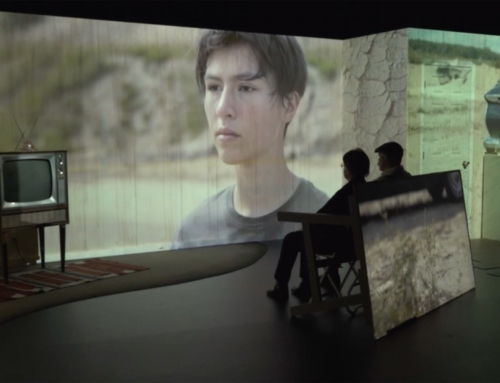En 2004, G. Thomas Couser publiait son livre intitulé Vulnerable Subjects : Ethics and Life Writing, dans lequel il discutait des questions éthiques entourant le geste de tout auteur qui écrit la vie d’une personne sur laquelle il exerce un certain ascendant. Cet ouvrage passionnant me pousse à me questionner sur l’éthique de mon terrain de recherche dans le cadre de ma maîtrise en création littéraire, pendant lequel j’emprunterai des récits de vie à des personnes queers dans le but de les fictionnaliser.
Or, les personnes queers sont-elles d’emblée des personnes vulnérables au sens où Couser l’entend, face à l’écrivain-étudiant qui les interviewe et à qui elles donnent leur consentement éclairé ? Quelles sont les frontières et les limites de ce consentement ?
Cet article s’attachera à tenter de définir les prémisses d’un cadre de la relation écrivain-étudiant/sujet queer, dans la perspective de mieux raconter l’histoire de l’Autre. Partant de la planification et de la méthodologie de mon terrain de recherche-création, je définirai les notions que j’ai retenues du « queer » et celle du « sujet vulnérable » selon Couser. J’appliquerai ensuite certaines des considérations éthiques développées dans son ouvrage à mon propre projet, et j’entreverrai les considérations esthétiques qui en découlent, ce qui devrait me permettre de tracer une ligne de conduite à tenir pour l’ensemble de ma création.
Travail de terrain et méthodologie
Mon projet de mémoire-création a pour titre : Nous sommes Amour, suivi de « Le “JE” emprunté : éthique et esthétique de la fictionnalisation de témoignages queers à propos d’amour ». Il se présentera sous la forme d’un recueil de courts récits poétiques dont chacun sera écrit au terme d’une entrevue semi-dirigée que je mènerai auprès d’un échantillon diversifié de personnes queers. Suivant les recommandations méthodologiques de Lorraine Savoie-Zajc (2000) pour ce type d’enquête, j’explorerai avec mes participant·es leur relation à l’amour en prenant comme point d’appui l’histoire vécue qu’ils·elles jugeront la plus significative. Je m’inspirerai de ces histoires pour en tirer un récit poétique fictif au « je », donc en empruntant, réécrivant et fictionnalisant l’histoire de celleux-ci, et dont l’ensemble devrait offrir un certain panorama de l’amour queer.
Queer et sujet vulnérable : points de convergence et de débat
Le queer est par définition un objet fuyant qui résiste à toute définition fixe. Je me base ici sur les travaux de Judith Butler (2006) et de Cathy J. Cohen (1997), mais également sur ceux de Chacha Enriquez et al. (2024). Ces derniers pensent le queer d’abord comme un projet politique qui vise à remettre en cause les rapports de pouvoir régulant les sexualités, les genres et les corps sexués. « Nous préférons penser le queer comme un projet politique de résistance, plutôt que comme une identité. Ce choix nous évite de figer le terme […] le queer, c’est ce qu’on fait et non ce qu’on est. » (2024 : 12) Tenant toutefois pour acquis que « ce qu’on est » façonne nécessairement, au moins en partie, « ce qu’on fait », qui vais-je donc considérer comme cet « Autre-queer » dans le cadre de mes travaux ? Il s’agira de toute personne qui se définit comme queer et dont l’identité diffère de la mienne, au niveau du genre ou de l’expression de genre, de l’orientation sexuelle, de l’origine ethnoculturelle ou du statut socioéconomique. En tant qu’homme blanc cisgenre homosexuel et travailleur autonome dans le milieu culturel, j’occupe une position dans l’éventail queer qui me confère certains privilèges par rapport à d’autres personnes plus marginalisées que je recruterai pour mon enquête.
Or, jusqu’à quel point les queers se qualifient-ils·elles comme des sujets vulnérables au sens où l’entend Couser en matière de récit de vie (life writing) ? Celui-ci nous offre une définition large du concept, l’étendant à toute personne en état de dépendance, soit sous l’effet d’une maladie, d’un handicap, d’un faible niveau de littéracie, d’une institutionnalisation, d’une minorité au sens légal, d’une incompétence ou d’une maladie incurable, et qui doivent se fier à des personnes qui ont davantage de pouvoir ou qui sont plus privilégiées qu’elles pour entendre, articuler et raconter leur histoire. (2004 : 16[1])
Alors, est-ce condescendant, déresponsabilisant, désagentivisant de considérer d’emblée les queers comme des personnes vulnérables, ou au contraire, est-ce appliquer ici un principe de précaution éthique primordial à mon projet ? De toute évidence, l’ensemble des personnes queers ne cadrent pas dans cette définition du sujet vulnérable. Or, les dynamiques de pouvoir décrites par Couser, à travers moult exemples dans son ouvrage, me portent à croire que personnes queers et personnes vulnérables présentent des similitudes dont je devrai tenir compte.
Considérations éthiques
Pour déployer ses réflexions, Couser prend appui sur des principes tirés de la recherche biomédicale, la plus sévère en matière d’éthique, car, argumente-t-il, celle-ci peut faire peser un risque grave sur la vie de sujets humains. Bien sûr, le consentement libre, éclairé et continu est la condition première de toute relation sujet/écrivain·e. Or, celui-ci peut être mis à l’épreuve : « Les relations consensuelles qui impliquent une coopération dans la confiance ont un potentiel unique de tricherie. […] Celleux qui dépeignent [les personnes avec une condition désavantageuse ou stigmatisante] doivent prendre soin de ne pas passer outre [override] leurs intérêts ni réécrire [over-write] leur histoire. » (2004 : 6-14) Couser attire au passage notre attention sur ce qu’il nomme « l’effet Schéhérazade » : « Alors que [l’écrivain·e] s’évertue à faire parler son sujet, le sujet s’évertue à maintenir l’écoute de son auteur. Il·elle vit dans la peur de se révéler inintéressant·e. » (2004 : 5)
Quatre grands principes doivent ainsi être pris en compte lorsqu’on cherche à préserver l’éthique de cette relation privilégiée : le respect de l’autonomie, le principe de non-préjudice, celui de la bienfaisance et celui de la justice.
Par rapport au premier, Couser nous met en garde de traiter les sujets simplement comme des moyens pour arriver à une fin, c’est-à-dire, dans mon cas, pour vouloir écrire un bon texte : « Idéalement, les sujets des récits de vie devraient avoir l’opportunité d’exercer un certain degré de contrôle sur ce qui arrive avec leur histoire, incluant les secrets et les informations privées [qu’ils·elles révèlent à l’écrivain·e]. » (2004 : 19) Ainsi, réécrire leur histoire – en leur imposant une forme différente, par exemple – pourrait constituer une violation de l’autonomie des sujets.
Sur le principe de non-préjudice, Couser nous dit que « [p]lus les sujets sont vulnérables (moins ils sont capables de se protéger), plus les auteurs·rices doivent se montrer scrupuleux·ses d’éviter toute représentation inutilement blessante d’eux. » (2004 : 30) Quant au principe de bienfaisance, il s’agit non seulement de tenter de faire du bien à nos sujets en (ré)écrivant leur histoire, mais aussi et surtout, s’assurer qu’ils en tirent des bénéfices. Qui dit bénéfices potentiels dit également risques pour les sujets de « prêter » leur histoire à un·e écrivain·e : « Le consentement d’un sujet à se confier à un·e écrivain·e n’est pas une carte blanche, pas une cession de ses droits, plutôt un sacrifice volontaire de sa vie privée dans le but et l’espoir d’un certain bénéfice compensatoire. » (2004 : 22-23) Enfin, concernant le principe de justice, on doit chercher à rendre justice, mais aussi, favoriser un sentiment de communauté autour d’un projet d’écriture. Bien la représenter, en faire un portrait juste. J’y reviendrai.
Pour l’instant, quels bénéfices potentiels mes éventuels sujets pourraient-ils retirer du fait de se prêter à une telle aventure littéraire ? En premier lieu, le bénéfice de contribuer à une recherche créative et celui, réellement inestimable, de raconter et de partager son histoire vécue, avec, en fin de compte, celui du public d’y avoir accès. Tout le monde peut ainsi en tirer quelque chose – et apprendre de cet échange. À ce sujet, les travaux de Monica Michlin, notamment un article qu’elle a fait paraître en 2011, m’apparaissent particulièrement éclairants. Michlin fait le point sur l’état de la polémique autour du réel pouvoir de production de l’empathie dans l’expérience esthétique de la lecture. Michlin affirme que l’effet réel de production de l’empathie sur le lectorat, mis en contact avec des fictions qui présenteraient, par exemple, le portrait de personnes marginalisées, est au mieux incertain. Comment en effet mesurer le degré de sensibilisation auprès du grand public à la suite d’une telle lecture, ainsi que le degré de mise en action de celui-ci en faveur d’une cause ou d’une autre ? En tout cas, la littérature possède indéniablement un degré d’influence – réel ou imaginaire – sur le monde, car sinon, nous dit Michlin, les régimes politiques autoritaires de partout à travers le monde et dans l’histoire moderne ne prendraient ou n’auraient pas pris la peine de bannir certains livres de leur espace social. De manière similaire, l’effet qu’un texte peut produire sur la communauté qui y sera ainsi dépeinte peut représenter un bénéfice non négligeable pour les sujets qui s’y identifient, surtout lorsqu’on sait que les queers ont besoin, peut-être plus que jamais, de représentation et de visibilité à travers la littérature.
Enfin, les bénéfices pour les sujets peuvent être de nature pécuniaire, s’ils reçoivent une rémunération pour leur participation : « Selon mon évaluation éthique, le droit des sujets sur les revenus issus du texte et le contrôle qu’ils exercent sur celui-ci varient en fonction de l’ampleur de leur rôle dans le texte et du degré de leur implication dans sa production ainsi que du format de ce texte » (Couser, 2004 : 24). Or, dans le cas de ma propre recherche-création, advenant une publication éventuelle du recueil de textes produits à la suite de mes entrevues, on pourrait arguer que de partager les (maigres) droits d’auteur que j’en tirerais avec la vingtaine de sujets qui m’auront prêté leur histoire ne constitue pas une compensation financière très importante.
Quant aux risques encourus d’une telle participation, Couser mentionne un possible sentiment d’aliénation, de violation ou d’appropriation qui pourrait être vécu par un sujet – et traite du choc émotif qu’une telle réalisation pourrait leur causer. Un tel risque pourrait toutefois être compensé par les bénéfices que peuvent leur apporter une prise de conscience sur soi, ses attitudes ou ses comportements, ou un sentiment de validation, soit le fait de se sentir compris par l’écrivain qui aura réinterprété son histoire. De manière similaire, un sujet pourrait subir le choc de se reconnaître dans la fiction, et ce, même si le texte qui est tiré de son histoire est anonymisé et que les détails en sont considérablement transformés. De toute manière, Couser rappelle que l’acte d’écrire la vie de l’Autre est par essence partial, inadéquat, présomptueux et possiblement transgressif.
Considérations esthétiques
Ces réflexions éthiques posent un certain nombre d’enjeux esthétiques dans le geste de fictionnalisation que je m’apprête à mener. D’abord, sur le plan de la vraisemblance, comment retransmettre une histoire que je n’ai pas vécue de l’intérieur, avec le plus d’authenticité et de crédibilité possible ? Devrais-je reproduire le sociolecte précis de mes sujets ou au contraire, m’offrir une licence linguistique et syntaxique totale ? Et comment représenter de manière juste l’histoire de mes sujets ? Dans son ouvrage Traduction et violence, Thiphaine Samoyault évoque la justesse comme un concept qui englobe également la justice : « La justesse, c’est l’exactitude d’une représentation qui implique une justice […] Or, rendre justice implique un désaccord de base, un conflit qu’il s’agit moins de résoudre que de trancher. » (2020 : 108-109) Toujours selon elle, « [o]n peut évaluer la justesse d’une traduction à l’effet de communauté qu’elle produit. » (2020 : 113) Les travaux de Samoyault dans le champ de la traduction sont pour moi riches d’enseignement : après tout, fictionnaliser un récit de vie, c’est en quelque sorte le traduire. À mon avis, c’est ici qu’entre en jeu ce que je nomme le paradoxe de la trahison : parce qu’elle vient ajouter une couche d’invention à l’histoire de vie du sujet, la fiction donne paradoxalement au lectorat un accès plus grand à cette même histoire. Transformer l’histoire d’une personne par la fiction – et donc, en étant moins « fidèle à sa réalité », en la « trahissant » – peut ainsi la rendre plus accessible à travers l’acte d’écriture et celui de la publication éventuelle. Ce processus pourrait en définitive rendre davantage justice au sujet et à son histoire réelle.
Samoyault rappelle que la trahison revêt un caractère politique et que la traduction n’en est jamais exempte : « Le conflit existe [dans la traduction], il est affronté, il n’est pas déjoué. Le traducteur est amené à prendre une décision et à l’affirmer comme d’autres. De même, sa traduction s’affirme à la fois avec et contre l’original » (2020 : 53). Le parallèle avec mon projet de création est frappant. Les traducteurs·rices doivent obligatoirement faire des choix – de termes, de formulations, de sens – et ceux-ci sont liés à leur affectivité, à leurs préférences et à l’identification à des œuvres, des langues, des choix que l’on opère en traduisant – donc, en écrivant : « Ces identifications font qu’on se reconnaît dans l’autre au point de se l’approprier, de le déplacer. De le changer. » (2020 : 55) Enfin, conclut Samoyault, « [t]outes les grandes traductions sont néologiques. » (2020 : 77)
Lignes de conduite
En matière de création littéraire à partir de matériel humain, les règles éthiques ne devraient pas avoir valeur d’impératifs catégoriques, mais plutôt nous servir de lignes directrices tout au long de la conduite de notre geste d’écriture. En gardant bien en tête toutes les préoccupations qui précèdent dans l’équation complexe de la légitimité de l’écrivain, Couser nous encourage à intégrer une explication de notre démarche de terrain et d’écriture (« the story of the story ») dans le cadre d’une éventuelle publication de l’œuvre qui s’inspire du récit de vie d’autrui. Selon lui, un·e écrivain·e qui nomme les enjeux éthiques auquel il fait face à travers l’écriture de son œuvre a plus de chance de susciter l’adhésion de son lectorat… et de surcroît, l’empathie de celui-ci, oserai-je ajouter. Samoyault dit d’ailleurs ceci : « [la traduction] permet que des récits inédits, des histoires qui ne sont pas les nôtres mais qui nous concernent nous parviennent et nous atteignent. » (2020 : 147)
Tout compte fait, il vaut sans doute mieux établir le caractère vulnérable des sujets de l’écrivain-étudiant au cas par cas – et adapter en conséquence le degré de soins qu’on prendra à fictionnaliser leur histoire. Il n’y a donc pas de réponse unique à la question de déterminer le caractère vulnérable de mes futurs sujets queers. Mais il m’importe de garder un souci éthique – et esthétique – constant tout au long de mon projet.
[1] Toutes les traductions du texte de cet auteur sont de moi.
Bibliographie
BUTLER, Judith, Trouble dans le genre : le féminisme et la subversion de l’identité, trad. Cynthia Kraus, Paris, La Découverte, coll. « La Découverte-poche », 2006, 284 p.
COHEN, Cathy J., « Punks, Bulldaggers, and Welfare Queens », GLQ : A Journal of Lesbian & Gay Studies, vol. 3, no 4, 1997, p. 437‑465.
COUSER, G. Thomas, Vulnerable Subjects : Ethics and Life Writing, Ithaca, Cornell University Press, 2004, 234 p.
ENRIQUEZ, Chacha (dir.), Sexualités et dissidences queers, Montréal, Éditions du Remue-ménage, 2024, 455 p.
MICHLIN, Monica, « Voices that Move Us. Narrative Voice, Emotion, and Political Thrust in Contemporary American Literature », Revue française d’études américaines, vol. 130, no 4, Belin, 2011, p. 81‑95, en ligne, <https://shs.cairn.info/revue-francaise-d-etudes-americaines-2011-4-page-81?lang=fr&tab=texte-integral>, consulté le 11 septembre 2024.
SAMOYAULT, Tiphaine, Traduction et violence, Paris, Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2020, 206 p.
SAVOIE-ZAJC, Lorraine, « Chapitre 13 : L’entrevue semi-dirigée », dans Benoît Gauthier (dir.), Recherche sociale, 5e édition : De la problématique à la collecte des données, Québec, Les Presses de l’Université du Québec, 2000, p. 337‑360, en ligne, <http://ebookcentral.proquest.com/lib/uqam/detail.action?docID=3263794>, consulté le 8 novembre 2023.