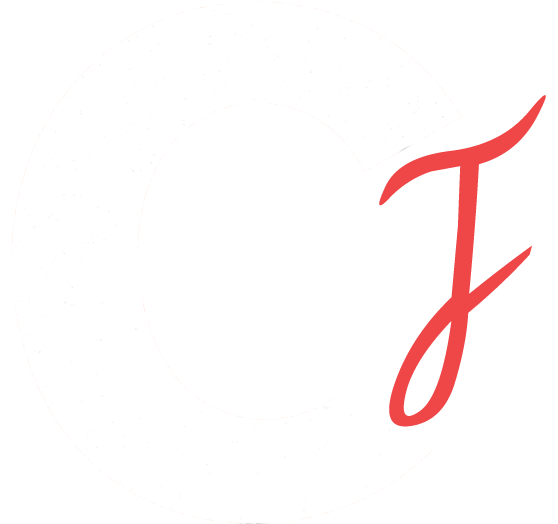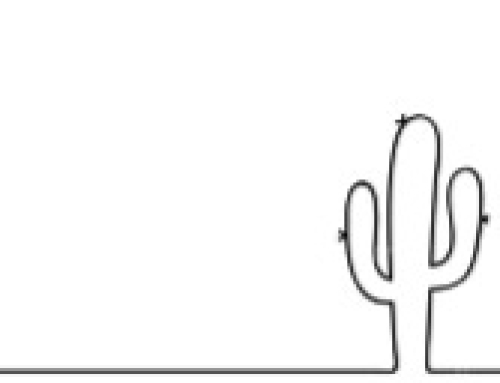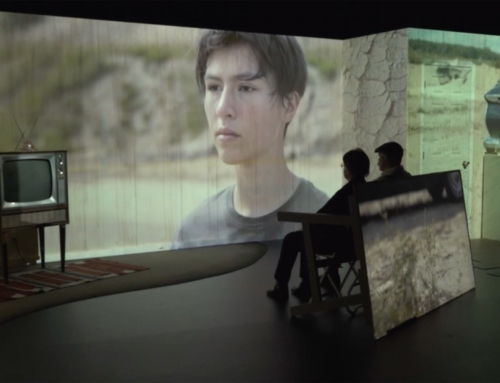J’ai profité du forum pour amorcer une réflexion à partir d’une question qui m’avait été posée et qui continuait de m’occuper l’esprit : « Quel est votre rapport à l’humour dans la création ? » Dans le cadre de la maîtrise en études littéraires, j’ai écrit un texte hybride de recherche-création qui interrogeait mon identité lavalloise, pressentie comme problématique, ainsi que mon sentiment d’impuissance politique. Pour donner forme à mon problème, je me suis appuyée sur les travaux de Christophe Hanna sur le dispositif poétique (2010), d’Olivier Quintyn sur le collage (2007) et de Franck Leibovici sur le document poétique (2007). Ceux-ci, s’inspirant du pragmatisme américain, conçoivent que face à une situation difficile qui se produit dans un environnement, il importe d’aller saisir au sein même de cet environnement les ressources pour y répondre. En ce sens, j’ai décortiqué le contexte lavallois du processus consultatif d’aménagement du territoire[1] pour appréhender mon identité lavalloise problématique et mon sentiment d’impuissance politique. J’ai prélevé des échantillons de discours de la documentation municipale (rapports de consultation publique, documents de présentation, projet de loi, etc.) afin de les réagencer et de les réécrire au sein d’une trame réflexive et dystopique. Ce retraitement de matériaux existants, ainsi que le collage de pratiques discursives, ou de façons de représenter une situation, rendent compte de la coprésence de visions du monde souvent incompatibles. Ils peuvent en outre donner lieu à des résultats surprenants, plaisants, absurdes, voire drôles. En explorant les pratiques de l’humour, de la parodie et de l’ironie, j’ai cherché les liens que ma pratique entretenait avec elles.
Bref survol lexicographique
J’ai circonscrit quelques usages de l’humour à partir d’Antidote (2024), d’ouvrages de références (Bergson, 1900 ; Dupriez, 1984 ; Sangsue, 1994 ; Sternberg-Greiner, 2003) et d’articles scientifiques (Henchoz, 2013 ; Saint-Martin et Gibeau, 2013). Débutant avec l’étymologie du mot « humour », celui-ci renvoie au latin classique humor, qui signifie « liquide », alors que sa définition réfère au fait de décrire des imperfections de façon drôle (Antidote, 2024). J’évacue la « façon drôle », parce que je ne veux pas m’occuper du comique ou du rire comme effet, mais plutôt de l’humour comme pratique d’attention au langage. Je retiens le mouvement du liquide et la description des imperfections, pensant à comment certains liquides, comme l’eau, répondent à la gravité : en se tenant au plus près des choses, en fuyant dans les craques, qu’on peut lire comme une métaphore de l’attention ou de la focalisation ; en outre, les liquides prennent la forme du récipient qui les contient, un comportement qu’on pourrait dire mimétique, évoquant les procédés parodiques et collagistes.
Si je ne m’intéresse pas au rire comme effet, le rire comme action ou intention me trouble. Selon Henri Bergson, « [il] est, avant tout, une correction. Fait pour humilier » (1900 : 83). Je creuse ce dessein hostile : « humilier », selon Antidote, signifie « rendre humble », dans son acception religieuse, et « abaisser par l’insulte et le mépris », dans l’autre. À sa suite, le fait d’être humble implique de faire preuve d’humilité ou de s’abaisser pour faire croire à quelqu’un qu’il est important, ou encore d’être modeste et sans éclat. On fait preuve d’humilité quand on est disposé à s’abaisser volontairement par sentiment de sa propre faiblesse, ou encore par grande déférence envers autrui (2024). En somme, « rire » est une dyade, qui s’établit de façon non équitable, alors qu’on est soit convaincu·e de sa propre faiblesse ou de la faiblesse de l’autre.
En ce qui a trait à l’ironie et à la parodie, la première est une superposition d’un dit et d’un non-dit (Hutcheon, 2001, cité dans Saint-Martin et Gibeau, 2013 : 27). Caroline Henchoz, qui a étudié l’humour et l’ironie comme tactiques pour dénoncer les inégalités au sein du couple hétérosexuel, les considère « comme des expressions satiriques [d’une] dissonance entre “ce qui est” et “ce qui devrait être” » (2013 : 84). La parodie, quant à elle, est « une imitation consciente et volontaire, soit du fond ou de la forme, dans une intention moqueuse ou simplement comique […] sensible que pour qui connaît le modèle », selon Dupriez (1984 : 331), et aussi elle se distingue du burlesque et de la satire, parce qu’elle est dépréciative, mais de façon joyeuse, selon Sangsue (1994 : 19).
Et on rit, et on rit (de Laval)
Dans mon mémoire, je me suis intéressée à mon identité lavalloise conçue comme problématique, parce qu’un jour, quelqu’un s’est présenté à moi en disant : « C’est rien contre toi, mais j’haïs Laval. » Au fil du temps, je me suis aperçue qu’il n’était pas le seul à mépriser ma ville natale, même si ce n’était pas toujours aussi frontal. Partout, on riait de Laval, avec la volonté sous-jacente de l’humilier, si on en croit Bergson. J’ai voulu collecter d’autres exemples de cette haine ou de cet humour dans les discours médiatiques et sociaux. Il va sans dire que cette forme de haine ainsi que ses effets sont dérisoires en comparaison avec les véritables formes de haine racistes, transphobes, homophobes ou sexistes. Néanmoins, certain·e·s arguent que la haine de Laval et, plus largement, des banlieues, est faite de la même étoffe. Par exemple, dans sa thèse Femmes sans foyer : subversion et reconduction de l’imaginaire banlieusard dans la littérature québécoise contemporaine (2023), Rosemarie Savignac émet l’hypothèse que la haine de la banlieue est intriquée à un mépris sexiste de la ménagère. De son côté, le créateur de contenu Mounir Kaddouri, alias Maire de Laval, relève la xénophobie qui motive la haine de Laval, sous la plume de chroniqueurs comme Frédéric Lacroix, qui sous-entend que le « fait français » est menacé par l’immigration (Kaddouri, 2024). Le·a Lavallois·e moqué·e a aussi eu d’autres traits : la peau orangée, des tatous tribaux, une Honda Civic, et plus récemment, une tendance à projeter des enfants par terre pour leur piquer leurs petits cocos. Malgré tout, sa plus grande tache demeure son lieu de résidence. C’est donc ce mépris ou cette haine légère qui m’a servi de matériau. Celle-ci génère assez de commentaires, de mèmes et de moqueries pour composer un environnement discursif duquel extraire des échantillons reconnaissables. Je les ai repris et remaniés pour en faire le moteur d’une dystopie dans laquelle la haine des Lavallois·e·s aurait justifié leur mise à mort ou au travail forcé. Pour traiter le deuxième volet de mon problème (mon sentiment d’impuissance politique), j’ai intégré dans la dystopie des extraits de la documentation de la consultation publique entourant la révision du schéma d’aménagement et de développement de la ville de Laval. En la réécrivant et en la remaniant, j’ai voulu déprécier de façon joyeuse la potentialité politique de sa démarche de participation citoyenne.
De la parodie : visée performative
Je n’emploie pas le terme « parodie » pour décrire mon travail, je parle plutôt de collage, de redescription, et de re-présentation de problème. Mais j’ai trouvé des éléments de comparaison dans l’article « “Exit les oreilles” : parodie, ironie et humour féministes dans Nunuche et Nunuche gurlz » (2013), de Lori Saint-Martin et d’Ariane Gibeau. Les autrices y analysent les moyens parodiques employés par Élise Gravel dans la revue Nunuche, parue en 2010, pour se moquer des magazines féminins, en poussant à l’extrême ou à l’absurde des thématiques généralement couvertes dans ces magazines : la quête de l’amour, ou plutôt de l’homme, les régimes, la chirurgie plastique, etc. Saint-Martin et Gibeau reconnaissent que « personne n’oblige les femmes à acheter Vogue, Châtelaine ou Elle ; aliénants, certes, ces magazines procurent aussi aux lectrices des satisfactions, des plaisirs et des compensations. Affirmer le contraire, c’est voir les femmes en dupes passives plutôt qu’en sujets agissants » (2013 : 37). L’objectif est donc d’apporter une perspective critique sans pour autant condamner la pratique qui revient à priver les femmes de leur agentivité en tant que consommatrices. Le magazine parodique Nunuche induit une autre lecture des magazines féminins, en exagérant à peine la féminité qu’ils mettent en jeu. Ce procédé accentue la dimension parodique des revues originales, une parodie qui n’est pas textuelle, mais sociale, disent les autrices (2013 : 38). Saint-Martin et Gibeau s’appuient sur la conceptualisation de Judith Butler selon laquelle « [la] parodie du genre révèle que l’identité originale à partir de laquelle le genre se construit est une imitation sans original » (2005, citée par Saint-Martin et Gibeau, 2013 : 32). Le genre parodie une fabrication qui se reconduit par la répétition de gestes, et Nunuche met au jour cette performativité du genre que reconduisent ces revues.
Imiter une expérience de langage
Le collage ou l’échantillonnage ou la littéralité peuvent-ils agir de façon parodique ? Après tout, ces pratiques se jouent de la répétition et de la préperformativité des énoncés. Le collage assemble des échantillons extraits de différents contextes d’énonciation. Ce sont des fragments d’énoncés existants, réinscrits dans un autre contexte d’énonciation. Ils portent en eux un caractère d’exemplification et d’implémentation. Quintyn emprunte ces notions au philosophe analytique, Nelson Goodman, pour expliquer comment l’échantillon rappelle la totalité énonciatrice de laquelle il est extrait, sans la synthétiser, en en présentant seulement des propriétés physique et sémantique (2007 : 36). À ce titre, l’échantillon exemplifie son contexte premier. Par sa réinscription, il fonctionne à la manière d’un ready-made, puisque la transformation qu’il subit ne concerne pas sa forme, mais son usage. La réinscription de l’échantillon dans un contexte esthétique transforme l’expérience qu’on en fait, sa lecture. Quintyn dit des échantillons qu’ils sont préperformés, qu’ils sont des médiations (2007 : 32). Puisque les médiums, comme les contextes d’énonciation, transmettent autant des techniques d’écriture, des moyens formels, que des visions du monde et des idéologies ; l’ensemble prescrit la façon de construire les messages. Je reviens à la parodie, parce que les notions de médiation et de parodie sans original me paraissent assez proches ; elles se répètent et se reconduisent elles-mêmes, au point où leur caractère factice se fait moins saillant : elles s’imposent comme naturelles, comme des règles à reconduire. En ce sens, le collage et la parodie réemploient ces règles pour s’en moquer, pour les démythifier, les dénaturaliser (St-Martin, Gibeau, 2013 : 28). En réagençant et redécrivant un rapport de consultation citoyenne, je pense qu’effectivement, je le parodie. Est-ce que, comme Nunuche, je parodie et traite la consultation publique ou la participation citoyenne à l’intérieur du cadre de la consultation publique comme une parodie sans original, renvoyant à une réalité qui n’existe pas, c’est-à-dire la réalité de la prise en compte de la parole citoyenne ? De fait, 90 % des recommandations issues des commissions parlementaires et des consultations publiques québécoises ne sont pas suivies par les décideurs (Dugas et Parenteau, 2006 : 306).
En outre, peut-on rapprocher la parodie-de-parodie, comme elle se déploie dans Nunuche, de la pratique de littéralité ? Dans sa thèse « Du “métier d’ignorance” aux savoir-faire langagiers : l’environnement de la littéralité chez Emmanuel Hocquard, Pierre Alferi et Jérôme Mauche », Philippe Charron conçoit cette dernière non pas comme un paradigme, mais comme une manière de se conduire avec le langage (2014 : 81). Cette attitude use de la répétition, à partir d’une conception du langage qui n’est pas sans rappeler la conception du genre de Butler, notamment sa dimension performative. En effet, Charron déplie cette conception à partir des premières œuvres d’Hocquard, dans lesquelles l’écrivain décrit son expérience pénible d’apprentissage de la langue, comme une « grammaire préréglée », qui s’acquiert par « l’inculcation de notions normatives et procédant de la répétition et de la reproduction » (2014 : 43). Comme le genre, qui se construit à partir d’une imitation sans original, la langue s’apprend par l’imitation, indépendamment des choses auxquelles elles se rapportent : « Les mots traitent de choses étrangères au lieu, et le monde auquel ils renvoient a cessé d’exister. » (Hocquard, 1980, cité par Charron, 2014 : 44) Cela suppose que le monde auquel les mots renvoient a déjà existé, ce qui n’est pas le cas du genre, mais on note quand même une dissonance entre ce qui est et ce qui devrait être. En outre, ce décalage fait état de l’historicisation des matériaux symboliques qui rendent compte de réalités désuètes, mais qui peinent à se renouveler dans l’usage.
Charron contextualise l’attitude littérale d’Emmanuel Hocquard en prenant comme point de départ la modernité négative et son rapport problématique et suspicieux à la signification. La conduite négative s’est inspirée du groupe des poètes objectivistes américains des années 1930 comme Zukofsky, Reznikof, Oppen. Pour ceux-ci, « l’objet de ce qui est exprimé ne devait pas être une idée indépendante de l’expression, mais l’expression elle-même, c’est-à-dire que ce qui se disait ne se concevait pas indépendamment des moyens avec lesquels on le disait » (Charron, 2014 : 29). Cette posture « nous place hors d’un simple rapport représentatif avec le monde », ajoute Charron (2014 : 29). Pour Hocquard, une expérience singulière du langage se dégage de cette conduite littérale, obtenue par la répétition ou la copie d’énoncés (Charron, 2014 : 79). En outre, « [la] littéralité ne peut concerner que ce qui [relève] à la lettre du langage (oral ou écrit). […] Il s’ensuit que si on parle de littéralité, on parle d’une proposition déjà formulée, oralement ou par écrit, quelle que soit, par ailleurs, la vérité de l’énoncé » (Hocquard, 2001, cité par Charron, 2014 : 79). Ce qui est mis en jeu est une pratique discursive singulière, un rapport singulier au langage, qui peut servir de méthode pour à peu près n’importe quelle forme de vie et pour les jeux de langage qui y sont intriqués. Les formes de vie ou les contextes sont aussi des points d’intersection qu’on capture, une photographie de leur confluence à un moment donné. Cette confluence capturée se raconte ou est montrée par l’expression elle-même. En ramenant l’attention à la surface du langage et en ouvrant des potentialités, d’autres apprentissages du langage sont possibles.
Parodie, collage et joie
C’est aussi mon expérience singulière du langage que je capture dans le cadre de mon mémoire. J’y combine les contextes de la consultation, de publications et de commentaires Facebook traitant exclusivement de haine, de ma vie à Laval (composée principalement de souvenirs de trajets à pied et en voiture) et de l’université (ses contraintes, les orientations de la réflexion sur le processus créateur). J’exprime une dissonance entre ce que Laval devrait être : un milieu de vie que je peux transformer par l’expérience, et qui me transforme en retour ; et ce que Laval est : un environnement anéanti par des interactions invisibles. Des pancartes « à vendre » ou « vendu » sont plantées dans des boisés abstraits en nombre d’hectares ; des cartes et leurs légendes de couleurs afférentes substituent aux milieux végétalisés et humides des zones d’usages industriel ou commercial. L’imitation critique se joue dans cet espace, montrant que ce n’est pas moi qui suis drôle, mais plutôt les conseillers municipaux et les promoteurs, bien installés dans leur expérience singulière très publique du langage.
Plutôt que d’entretenir un rapport fataliste vis-à-vis de la dissonance entre ce qui est et ce qui devrait être, qu’il soit question de conditions de vie ou d’un rapport au réel, de ce qu’on veut faire croire du réel, à coup d’éducation contraignante, Hocquard préfère baisser ses attentes envers le langage et sortir des visées ontologiques et métaphysiques de l’expression. Se penchant sur des énonciations particulières et refusant quelque démarche totalisante, Hocquard réalise des connexions dans le langage qui lui procurent une grande satisfaction, « une jubilation provisoire qui survient […] lorsqu’il remédie à un blocage, à élucider un cas, par la réorganisation des ressources habituelles et des formes de langage les plus ordinaires » (Charron, 2014 : 229). Le collage et la littéralité procèdent d’une mise à plat des usages conçus comme autant de ressources à disposition. Cette mise à plat opère sans doute différemment de la parodie, mais contribue en tout cas à démythifier les mêmes usages en les déhiérarchisant. On peut alors les réorganiser et tester des combinaisons, lesquelles peuvent parfois être surprenantes. Charron distingue cependant l’humour et l’ironie, la seconde se jouant du dédoublement de la signification et le premier se jouant de l’imprévisibilité, mais aussi de la multiplicité des usages à disposition, en faisant un usage non standard du langage : « Comme le suggère Wittgenstein, attribuer de la crédibilité à ce qui apparaît saugrenu,[sic] nous permet d’organiser autrement ce avec quoi nous transigeons, autorise, à travers l’établissement de nouvelles connexions, de jeter une lumière différente sur les faits. » (2014 : 148)
Un humour discret ou une contestation douce
En ce sens, la littéralité crée un espace dans la répétition, non pas un message, ou un non-dit, mais une possibilité d’action. Hocquard se base sur Rosset, prenant la mimèsis comme une « répétition sur le mode ludique et enfantin du “on ferait comme si’’ » (Hocquard, 1987, cité par Charron, 2014 : 225). La parodie révèle le caractère factice des usages en les reconduisant et les exagérant ; le collage, en les reconduisant et les recontextualisant. Or, ces reconductions fonctionnent à condition qu’elles soient reconnues comme critiques, qu’elles ne soient pas trop discrètes. Cette condition est explicitée par Caroline Henchoz, dans son article « De l’humour féminin comme d’une compétence sociale pour gérer et contester les rapports de pouvoir et les inégalités dans le couple » (2013). L’autrice fait valoir que l’humour dont usent les femmes dans le cadre des entretiens qu’elle mène auprès d’elles et leurs conjoints, agit comme une tactique de subversion douce. Elle allègue que bien que ces confrontations ne mènent pas forcément à une discussion explicitant les dynamiques, elles ouvrent des brèches en cultivant une complicité avec leur partenaire, une condition nécessaire à l’humour. Le rire assure qu’une partie du message est comprise, que l’autre reconnaît l’inégalité signalée en riant, et que les conditions sont en place pour désamorcer un conflit, ouvrir une discussion. En quelque sorte, le message passe parce qu’on fait de l’interlocuteur un allié plutôt qu’un adversaire, reportant la responsabilité de l’inégalité sur un système pour créer une solidarité dans la crise. Le risque est d’édulcorer la dénonciation de l’inégalité ou du comportement. Henchoz désigne cette tactique de compétence par une contestation douce, qui conduit lentement au changement social. Ces contestations douces rappellent les bonnes connexions que réussit Hocquard quand il juxtapose des énoncés, les effets d’étrangeté qui se dégagent du collage et de la parodie de revues féminines. Si ces procédés ne résolvent rien, ils instiguent un doute sur nos pratiques et leurs environnements de pensée, et peuvent « désarmer » (une propriété de l’humour, selon Rosenberg [2009]) la personne réceptrice, c’est-à-dire atténuer les risques d’agression, de résistance et de suspicion, notamment dans le contexte d’une conversation difficile. Il importe, cependant, que les expériences de langage mises en jeu soient repérées. Comme la parodie et l’ironie, le collage et la littéralité demandent un certain degré de complicité et des référents communs pour s’activer de façon critique, autrement leur discrétion estompe la possibilité d’action qu’elles mettent en scène.
[1] En 2014, la Ville de Laval a lancé une démarche de participation citoyenne pour consulter la population au sujet de plusieurs projets d’aménagement, dont la révision de son schéma d’aménagement et de développement, ainsi que son règlement d’urbanisme.
Bibliographie
Antidote 11, version 6.1.1, logiciel, Montréal, Druide informatique, 2024.
B., Daphné et Mounir KADDOURI, « crumbl politique », dans café snake, 3 septembre 2024.
BERGSON, Henri, Le rire. Essai sur la signification du comique, Paris, Éditions Alcan, 1924 [1900].
CHARRON, Philippe, « Du “métier d’ignorance” aux savoir-faire langagiers : l’environnement de la littéralité chez Emmanuel Hocquard, Pierre Alferi et Jérôme Mauche », thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal, 2014.
DUGAS, Sylvie et Ian PARENTEAU, Le pouvoir citoyen : la société civile canadienne et québécoise face à la mondialisation, Montréal, Fides, 2006.
DUPRIEZ, Bernard, Gradus : Les Procédés Littéraires : Dictionnaire, Paris, 10/18, 1984.
HANNA, Christophe, Nos dispositifs poétiques, Paris, Questions théoriques, 2010.
HAREL-MICHON, Mélanie, « À nous Laval! Cahier de participation dystopique à la consultation citoyenne », mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, 2024.
HENCHOZ, Caroline, « De l’humour féminin comme d’une compétence sociale pour gérer et contester les rapports de pouvoir et les inégalités dans le couple », dans Recherches féministes, vol. 25, no 2, (JOUBERT, Lucie et Brigitte FONTILLE [dir.], Les voies secrètes de l’humour des femmes), Québec, janvier 2013, p. 83‑102. https://doi.org/10.7202/1013524ar.
JOUBERT, Lucie et Brigitte FONTILLE, « Présentation », dans Recherches féministes, vol. 25, no 2, (JOUBERT, Lucie et Brigitte FONTILLE [dir.], Les voies secrètes de l’humour des femmes), Québec, 2012, p. 1. https://doi.org/10.7202/1013519ar.
LEIBOVICI, Franck, Des documents poétiques, Marseille, Al Dante/Questions théoriques, 2007.
QUINTYN, Olivier, Dispositifs/dislocations, Romainville, Al Dante/Questions théoriques, 2007.
SAINT-MARTIN, Lori et Ariane GIBEAU, « “Exit les oreilles” : parodie, ironie et humour féministes dans Nunuche et Nunuche gurlz », dans Recherches féministes, vol. 25, no 2, (JOUBERT, Lucie et Brigitte FONTILLE [dir.], Les voies secrètes de l’humour des femmes), Québec, janvier 2013, p. 25‑41. https://doi.org/10.7202/1013521ar.
SANGSUE, Daniel, La Parodie, Paris, Hachette, 1994.
SAVIGNAC, Rosemarie, « Femmes sans foyer : subversion et reconduction de l’imaginaire banlieusard dans la littérature québécoise contemporaine », thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal, 2023.
STERNBERG-GREINER, Véronique, Le comique, Paris, Flammarion, 2003.