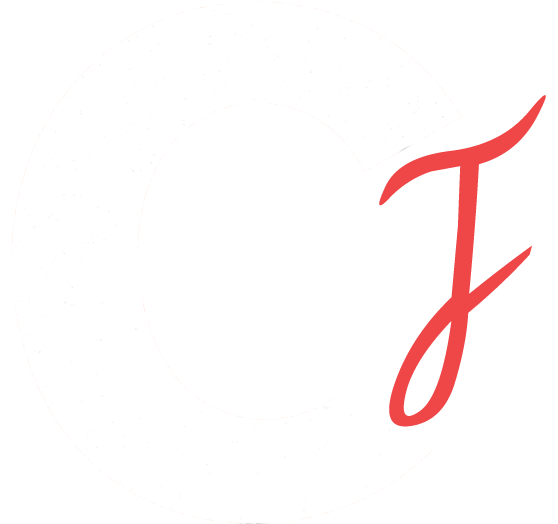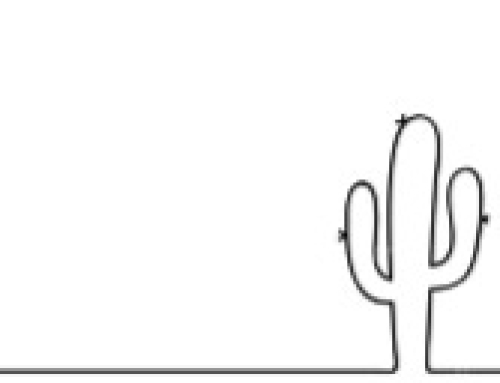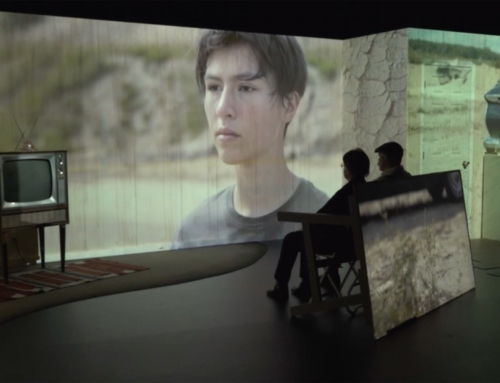Un premier contact
Un premier contact par courriel et déjà une petite étincelle émerge en moi. Marie-Sissi détient le secret pour insuffler une ambiance sympathique en peu de mots empreints d’un naturel désarmant. On se dit « tu » d’accord ? Ça me plait. Une couche de stress disparaît instantanément, me laissant présager que cette entrevue saura répondre à mes attentes tout en étant agréable à réaliser. Je me sens donc fébrile à l’idée de pouvoir m’entretenir avec elle.
Aussitôt connectées sur Zoom, le charme se poursuit. Sourire franc. Accueil chaleureux. Cette rencontre en visioconférence glisse tout naturellement sur quelques échanges spontanés initiés par Marie-Sissi. Je me sens happée par la simplicité avec laquelle elle aborde notre conversation. Elle, écrivaine talentueuse, reconnue, primée, qui enfile succès littéraire après succès. Moi, étudiante, tout en balbutiements, nourrissant le désir de progresser dans mon style d’écriture au point d’attirer l’attention d’un éditeur, un jour. Nous cheminons assurément à des pôles opposés l’une de l’autre. Pourtant, l’ambiance laisse présager l’aplanissement du statut social pour la suite de la conversation au sujet de son parcours d’écrivaine.
Un retour dans le temps, avant Borderline
Marie-Sissi a mentionné en entrevue que c’est après avoir lu La grosse femme d’à côté est enceinte de Michel Tremblay qu’elle a su qu’elle voulait devenir écrivaine. Je me demande ce qui s’est passé à l’intérieur d’elle pour que ça éveille ce désir de façon aussi évidente.
Marie-Sissi me répond qu’elle écrivait déjà depuis son très jeune âge, bien avant de lire Michel Tremblay. Elle ne le disait à personne et conservait ses textes dans le plus grand secret. À cette époque, elle ne pensait pas qu’elle pouvait devenir écrivaine. Elle nourrissait surtout la conviction qu’il faut savoir écrire autrement qu’en se référant au langage populaire si l’on souhaite rejoindre le rang des écrivains, probablement pour la plupart des hommes à cravates, s’imaginait-elle à ce moment-là. Quant à elle, emportée par la fougue de sa jeunesse et par son besoin de s’exprimer, elle écrivait comme elle parlait, inventait des histoires rocambolesques et, dans son imaginaire littéraire, elle baisait avec Boy George.
Marie-Sissi précise qu’elle vient d’un milieu où il n’y avait pas de livre à la maison. La culture était absente de son univers. On parlait comme on apprend à parler dans un milieu défavorisé. Un langage très loin de celui qui s’écrit dans les livres, pensait-elle. Une conviction ferme, même si elle confie qu’elle ne lisait pas du tout avant d’ouvrir les pages de ce fabuleux livre de Michel Tremblay après y avoir été incitée fortement par une amie : « Tu vas aimer, j’en suis certaine, lis-le ! » Dès les premiers mots, les premières phrases, étonnée, Marie-Sissi vit un choc. Le roman de Michel Tremblay, ancré dans le langage populaire, devient une révélation pour elle, « On peut faire ça. On peut s’exprimer comme ça dans les livres ». Ce constat a remis en cause ses fausses croyances à propos de l’écriture littéraire. Elle pouvait désormais s’en défaire et se reconnaitre, ce qui a éveillé son désir de devenir écrivaine et fut à l’origine de son apparition dans l’univers littéraire quelques années plus tard.
On peut se demander alors pourquoi elle a fait des études en psychologie plutôt qu’en littérature alors qu’elle en rêvait. Déjà inscrite en psychologie au cégep, elle a tout naturellement décidé de poursuivre ses études dans ce domaine. Elle songeait alors à devenir sexologue. Elle ajoute, avec un sourire et un timbre de voix empreint de tendresse, qu’elle trouvait « amusant que son choix professionnel gêne sa mère ». Il faut surtout dire que la raison majeure qui lui a fait emprunter ce détour résidait dans son manque de confiance en elle. Ce poids qu’elle trainait a eu pour effet de repousser son projet de devenir écrivaine. L’impact du roman de Michel Tremblay, bien que déterminant, n’aura pas été suffisant à ce moment-là.
Ses débuts en tant qu’écrivaine
Sa première œuvre littéraire, Borderline, publiée en l’an 2000, a obtenu un succès instantané. Cette reconnaissance lui a-t-elle permis de développer sa confiance en elle ? Eh bien non. « J’ai un énorme complexe d’infériorité. C’est un combat de tous les jours. Je me dis que j’ai eu un coup de chance, que les autres sont meilleurs que moi. » Détentrice d’une maitrise en littérature, bonifiée de ses succès littéraires par la suite, sa perception d’elle-même persiste, encore aujourd’hui, à lui donner du fil à retordre.
Notre entretien a lieu le 10 octobre 2025, soit la journée mondiale de la santé mentale. Alors pourquoi pas aborder le sujet ?
Avant et après la parution de Borderline, considérant qu’il s’agissait d’une autofiction en lien avec la santé mentale alors qu’il y avait beaucoup de tabous à cette époque, comment se sentait-elle face au regard de son lectorat et du public ?
« Pas vraiment mal. »
Elle ne sait pas d’où ça vient, mais elle ressent le besoin d’aller vers le danger : « J’ai un énorme besoin d’exister comme ça. Une énergie qui prend le contrôle. » Elle précise : « Ça m’a pris neuf mois à écrire Borderline, le temps d’un accouchement. » Tout un accouchement, en effet, avec son succès instantané ! Elle explique qu’une grande partie de sa vie a été parsemée de vrai, de faux, d’incertitudes, un peu comme si son vécu avait pris la forme d’une autofiction au quotidien. Par exemple : « La rumeur circulait que mon père était un voleur de banque, mais je n’ai jamais su, même encore aujourd’hui, si c’était vrai ou pas. »
Juste avant la parution de son livre, elle s’est mise « à capoter » : « Je ne voulais plus que le livre sorte, je ne voulais pas que ma mère et ma famille puissent le lire. Je doute toujours de moi. Puis après, ça s’est bien passé. Ma famille ne l’a pas lu », ajoute-t-elle avec émotion.
Et lorsqu’elle a appris que son œuvre Borderline serait portée à l’écran, donc susceptible d’être vue par une grande tranche de la population, comment a-t-elle vécu cela ?
« J’étais contente. »
Elle n’était pas affectée par le regard des autres. « Il faut dire qu’avec la scénarisation, les modifications, ce n’était plus complètement moi », s’empresse-t-elle de préciser.
Tout récemment, elle publie Ne pas aimer les hommes
Au cours d’une entrevue à l’émission télévisée Bonsoir, Bonsoir, Marie-Sissi parle en toute transparence de sa récente parution Ne pas aimer les hommes. Je la questionne sur ce que ça lui fait vivre de relater des souvenirs d’un passé souvent douloureux en les faisant renaître par l’écriture, pour ensuite en témoigner en entrevue télévisée, d’autant plus qu’il s’agit de trois récits inspirés de souvenirs marquants dans sa vie. « Ce sont des souvenirs tellement loin que ça ne m’affecte plus. Après dix ans d’analyse avec ma psy, j’ai même l’impression que je parle de quelqu’un d’autre. »
Mais une fois l’écriture terminée, elle s’est quand même dite interpellée par le fait d’avoir vécu tout ça. « C’est quand même beaucoup de souffrance. Je me suis rendu compte aussi que j’étais une proie facile. Et pourtant, non, ce n’est pas douloureux de replonger dans mes souvenirs. »
Elle ajoute en riant, et je paraphrase, qu’il faut bien que dix ans de thérapie puissent avoir eu des résultats intéressants ! Marie-Sissi évoque le fait qu’elle a même aimé ça écrire ce livre, qui provient d’une commande de son éditeur.
Une quadruple publication en 2025
Marie-Sissi a publié en février 2005 Un roman au four avant son tout dernier livre Ne pas aimer les hommes. Je suis curieuse de savoir comment elle a réussi ce tour de force. J’apprends alors qu’elle a publié non pas deux, mais bien quatre livres en 2025 puisqu’elle a aussi publié deux livres pour enfants. « Je ne sais pas comment j’ai fait », affirme-t-elle. Je lui suggère qu’elle a surement beaucoup d’énergie. Eh bien non, même qu’elle se sent souvent fatiguée. Le mystère demeure pour elle, et pour moi, étant impressionnée par cet exploit d’autant plus qu’elle a écrit Ne pas aimer les hommes en seulement quatre mois. Une autofiction bien ficelée qui nous garde en haleine alors que la virtuosité de son écriture, découlant d’un langage simple et efficace, nous traverse de page en page pour ce récit : captivant, surprenant, émouvant, déchirant parfois.
Son processus d’écriture
Je me suis intéressée à son processus d’écriture, à la discipline qu’elle s’impose, son modus operandi en quelque sorte. Sa réponse fut toute simple : « De façon générale, j’écris tous les jours. Pas toute la journée, pendant deux heures environ, le matin. » Bien sûr, elle s’attaque aussi à la réécriture pour mener ses manuscrits à terme, une phrase après l’autre.
Je me suis demandé comment les mots se révèlent à elle. A-t-elle des trucs qui la mettent en état d’écriture ?
Elle témoigne avoir beaucoup appris à écrire de la façon suivante : « Je lis, je lis, je lis, j’écris, j’écris, j’écris. Je me connecte sur mon vécu, les vraies affaires, et je l’écris, mais pas de façon plate. Dans Borderline, c’est sorti en un jet. J’avais tellement besoin de l’extérioriser. En fait, j’écris à partir de là où ça fait mal. »
Je lui mentionne que Jean-Noël Pontbriand, professeur retraité de l’Université Laval (elle ne l’a pas connu pour avoir fait ses études en littérature à Montréal) tenait littéralement le même propos : « Écrivez là où ça fait mal », disait-il en s’adressant à ses étudiantes et étudiants dans son cours de poésie. Elle m’a semblé étonnée. Comme si son opinion et sa façon de procéder pour écrire pouvaient être ainsi validées par un professeur d’université. J’ai cru y voir un relent de son manque de confiance en elle.
Quoi qu’il en soit, impossible de ne pas réaliser que, dans son écriture, il y a une grande part de déchirement. Cela s’exprime par un langage parfois cru, mais se révèle avec un éclat d’une étrange beauté. Je lui avoue que sa façon singulière de livrer son vécu me va droit au cœur. Je lui cite un exemple parmi d’autres : « Comment distinguer le vrai du faux quand, à la maison, on vous dit que tout va bien alors qu’on a la lame de rasoir sur l’artère fémorale ? »
En terminant
Ça fait déjà trente minutes que je m’entretiens avec Marie-Sissi. Tout a passé tellement rapidement. Je ne veux pas abuser de sa générosité.
Autant de publications dans la même année, ce n’est pas rien ! J’imagine qu’elle a l’intention de prendre une pause avant de penser à son prochain livre. « Oui, oui. Mais pas trop longtemps, par exemple », s’empresse-t-elle de préciser.
Un temps d’arrêt qui se prolongerait au-delà de cet appel de l’écriture qu’elle ressent intensément pourrait faire en sorte qu’elle manque d’air. Elle semble écrire comme elle respire. Elle m’a d’ailleurs précisé qu’écrire lui donnait l’impression d’exister : « Écrire est la seule affaire qui me tient. J’en ai besoin. »
Avec enthousiasme et reconnaissance, je lui exprime mes remerciements pour m’avoir accordé généreusement de son temps. L’entretien se termine comme il a débuté : une très belle rencontre humaine. Je ne pouvais demander mieux. Un grand merci à toi, Marie-Sissi !
J’ai presque envie de dire que, si vous n’avez pas encore lu Marie-Sissi Labrèche, allez à sa rencontre, vivez l’expérience. Plongez dans son univers pour sa sensibilité, pour l’aventure littéraire qu’elle nous propose à même ses expériences de vie, voire pour une leçon d’écriture aux écrivaines et écrivains en devenir. Sa maitrise de l’autofiction saura vous surprendre tout en brouillant un peu les pistes entre le vrai et le faux de son histoire personnelle.
L’émotivité, la beauté et l’éclat de son écriture littéraire transpirent à chacune des pages de sa plus récente parution, Ne pas aimer les hommes.
Personnellement, je suis remplie d’admiration pour son talent d’écrivaine. Avec son audace dans l’écriture, son côté pétillant et son franc-parler en entrevue, son charisme criant de vérité, comment ne pas tomber sous son charme. Comment ne pas aimer cette femme.