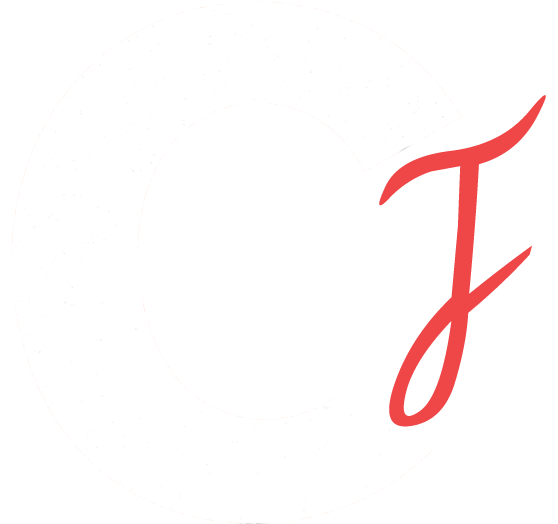La chanson comme support de la pensée intellectuelle
La chanson populaire constitue un tremplin idéal pour quiconque veut rejoindre la masse, un médium de choix pour l’artiste intellectuel qui souhaite inscrire sa pensée dans la sphère publique. La musique répond en effet à ce besoin d’instantanéité, de concision et d’accessibilité qui prévaut de plus en plus dans la société actuelle, incarné notamment dans les réseaux sociaux du type Twitter (accès facile et rapide à tout ce qui se passe, dans un nombre limité de caractères). Facile à transporter, n’exigeant pas nécessairement d’efforts pour l’apprécier et capable de livrer un sens dans une limite temporelle assez restreinte, la chanson comporte plusieurs qualités formelles qui en font un vecteur important de la construction identitaire et de la transmission de la culture à l’heure actuelle, en plus d’éveiller les consciences quant à divers enjeux sociaux, politiques et environnementaux.