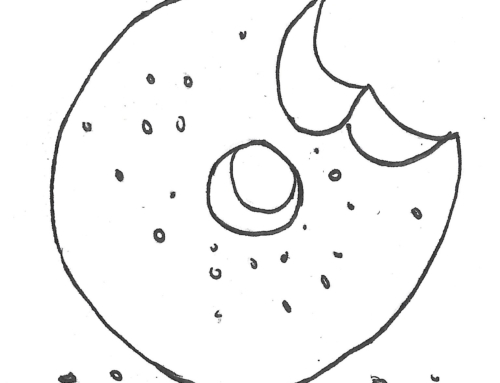Ce texte a été écrit dans le cadre du cours Écriture de fiction I (roman), donné à l’Université Laval par Pierre-Luc Landry à l’automne 2012.
I
ENFERMEMENT
18 h
Les repas congelés, pour tout dire, m’exaltent, m’emballent, me ravissent, me réjouissent, me comblent. Pour cette raison, je les achète au jour le jour, un par un : répéter ces mêmes instants parfaits, sans cesse.
Cet enivrement m’a permis de tisser une profonde amitié avec le micro-ondes. N’allez pas croire que la chose m’attriste, loin de là. En récompense de mon insondable patience, le temps analogique qui passe me murmure : Bip! Bip! Biiip! Précisément le même son que celui d’un moniteur cardiaque. Coïncidence? Tout est calcul.
Déposer la serviette de lin tissé devant le micro-ondes, toujours la même serviette de lin, toujours au même endroit, toujours. On ne se fait prendre qu’une seule fois à mettre sa main sous un plat de plastique brûlant. Faire pression sur le bouton-poussoir du micro-ondes, contrôler cette pression; il ne faut rien brusquer. L’important restera ma main gauche : à l’affût à chaque instant de la manœuvre. Prête, elle attrape la porte du micro-ondes, l’empêchant du même coup d’aller se heurter contre le mur. J’ai en horreur le toc qui se produit lorsqu’elle le frappe : la plainte sourde du gypse défraîchi m’horripile – personne ne vient ici, pourquoi aurais-je repeint? Ce bruit signifierait l’échec de mon entreprise, la perte de contrôle : il ne faut jamais perdre le contrôle. Immobile, elle se doit de rester immobile.
Devant moi s’ouvre l’antre du micro-ondes taché par le temps et les aliments. Qui prendrait conscience de cette saleté? Personne. Sa lumière ternit mon repas. Ils devraient proposer plusieurs types d’éclairage lors de l’achat; le consommateur se doit de pouvoir choisir. Moi-même, je préférerais qu’une douce lueur se pose sur mon festin, il ne mérite pas une telle agression. Mes doigts pincés se déposent de chaque côté du récipient noir. Il faut s’assurer d’une symétrie parfaite dans ce genre de mouvement. Les pianistes ne connaissent rien à la précision. Rien.
- Vérifier que le repas repose du bon côté;
- Ouvrir l’emballage par l’extrémité droite, ne pas déchirer;
- Retirer le repas en glissant la boîte vers la gauche, tout en tenant fermement le rebord de plastique du plat;
- Percer la pellicule plastique;
- Chauffer au micro-ondes quatre minutes trente;
- Procéder au retrait du repas;
i. Soulever délicatement le repas;
ii. Le déposer sur le carré de lin;
iii. Respecter les conseils du fabricant; - Déguster sur la table, face au cadre de nature morte.
J’en étais à soulever, étape 6.i.
L’ordre d’exécution de ma tâche est inscrit sur cette feuille de papier kraft collée sur le clavier numérique du micro-ondes. Cinq carrés y sont percés, encadrant le 4, le 3, le 0, le bouton pressoir et le start. Avant que ces instructions ne soient posées là, j’évoluais dans une peur constante; et si j’oubliais une étape?
Sous le commandement de mes mains, l’assiette de plastique se met en mouvement. Un spectacle, le plus beau des spectacles, se déroule alors devant moi. Les perles d’évaporation collées contre la pellicule plastique ont quelque chose de rassurant : bien qu’elles aient tenté de s’échapper pendant quatre minutes trente, une barrière translucide les emprisonne toujours. Elles restent là, à se débattre au rythme de mes pulsations cardiaques qui leur parviennent doucement du bout de mes doigts. Stoppant net ce savoureux moment, je dépose le plat encore chaud sur le carré de lin. Sous mon regard, les prisonnières demeurent impassibles.
Je n’ai rien à voir avec cette torture. La boîte l’indique clairement : laissez reposer deux minutes avant de consommer. Plaisir, attente. C’est sous les ordres du fabricant que je profite de ma minutie, de ce tableau de bulles d’eau condamnées. Cette lente agonie me fascinera toujours. Coincées sous une barrière invisible, l’angoisse. Je savoure chaque seconde de leur confinement. Contre ma plus grande volonté, il arrive que certaines retombent sur la nourriture, abandonnant leurs efforts de suspension. Elles se laissent tomber, lâches!, pour enfin disparaître dans la sauce de mes macaronis, comme pour rebrousser chemin. Le regret, sans doute.
Bientôt, une nouvelle source de joie. La pellicule plastique. Il importait dès le début, bien avant de faire cuire, de la transpercer doucement mais fermement avec une fourchette. Chaque fois, il prime de m’assurer que le tout soit symétrique, parfaitement symétrique. Hors de question de percer cette chose fragile sans un certain ordre. J’aime entendre le plastique craquer sous la pression des dents pointues, toujours la même – personne ne vient ici, pourquoi aurais-je plus de trois couverts? Les rangées de petits trous sur la pellicule s’alignent à la perfection. Quoiqu’impressionnante, la réussite de cette entreprise s’avère beaucoup plus simple depuis que j’utilise cette règle de métal, déposée au-dessus du micro-ondes.
Maintenant, il faut retirer la pellicule sans la briser, surtout ne pas la briser. Je me dois aussi d’empêcher le maximum de gouttes d’eau de s’échapper, aucune n’est autorisée à tomber. Délicatement, lentement, précautions, précautions, précautions, lentement, patience, patience…
N’importe qui croirait l’entreprise vaine, vu la faible force appliquée par mes mains. Sans doute un profane établirait comme physiquement impossible ma victoire contre la colle qui retient le plastique scellé autour de mon repas. Malgré ces médisances, ce pessimisme, la pellicule perd lentement sa lutte, stoïque, et dévoile de plus en plus mes macaronis. Peu à peu, les bulles s’écoulent en un même sens. La pente translucide les emmène vers une communion, une communion unique, comprimée. Soulagement : aucune d’elle ne tombera. Voyez, il suffit d’agir lentement. Tout ce temps qu’il me reste à exister. Avec regret, je pense à ces gens qui, en retirant la pellicule diaphane, la déchirent. Ils n’apprécient ni la vie ni le beau.
De toute façon, se presser, ce serait briser l’enivrement de l’attente. Plus que quelques centimètres de pellicule à détacher : le monde des possibles existe bel et bien. Et voilà que (peut-être un peu trop tôt) la pellicule roulée sur elle-même repose dans ma paume humide; personne n’a pu s’évader ce soir.
Je glisse ma main sous le carré de lin et effectue un lent demi-tour. Il faut maintenant me rendre deux petits mètres plus loin. Chaque soir, j’appréhende cet instant, l’incontrôlable pouvant se produire à tout moment : perdre pied équivaudrait à se faire hara-kiri – tant de minutie à la merci d’un tressaillement divin.
En fait, seulement sept pas, toujours sept pas, me séparent de la petite table à dîner. Carrée. Elle se trouve au centre de la cuisine depuis mon arrivée ici : un cadeau de l’ancien propriétaire. Sa mort avait entraîné la vente de l’appartement et aucun membre de sa famille n’avait réclamé ses biens. Ainsi, je n’ai pas eu à meubler la chambre non plus, tout était intact. Une aubaine. Draps, meubles, réfrigérateur et micro-ondes, pour rien du tout. En guise de remerciement, je m’étais rendu à son enterrement.
Au centre de la table, un ouvrage au crochet aux pourtours jaunis par le temps attend une deuxième vie. Voilà la cible à atteindre, ce napperon coquet qui donne de la richesse à mes repas. À petits pas, à sept petits pas bien contrôlés, je dépose finalement, en toute sécurité, le plat sur la table. Un dernier aller-retour. Il me faut rebrousser chemin et cueillir la fourchette utilisée plus tôt. Loin de moi l’envie de jongler avec un ustensile lors du transport de mon festin, ce serait là titiller la malchance. Respectons l’ordre des choses.
Soudain, au fil de mes sept pas bien comptés, une légère tension retient mon pied au sol. Ne plus bouger. Un des fils de mon bas gauche s’accroche sournoisement au parquet usé. Je dois enlever ma chaussette. Un plan, trouver un plan. Délicatement, je pose le bout de mon pied droit sur le petit espace de tissu laissé vacant entre mon extrémité pédestre et la couture de la chaussette. Je m’assure de la précision du geste et confirme une seconde fois la captivité de la proie de textile sous mes orteils tendus. J’ai sans doute l’air d’un étrange flamand rose; qu’importe, personne ne vient jamais ici. Se concentrer, ne rien laisser au hasard. Rigueur, rigueur, rigueur. Le hasard n’existe pas. Le hasard n’existe pas, le hasard n’existe pas.
Figé dans ma position aviaire, il ne me reste plus qu’à faire un pas de côté pour extraire mon pied de la chaussette prisonnière.
Le sol froid sous la plante de mon pied nu. Tenant toujours fermement la fourchette dans la main droite, je pose mes genoux l’un après l’autre sur le sol. Il me faut comprendre comment ce fil a pu se prendre et le déloger sans le casser, il ne faudrait pas briser ce bas, je n’en ai que sept paires, c’est bien suffisant. L’odeur de mon repas qui m’attend sur la table s’immisce dans mes narines. Rien ne m’extraira de mon entreprise.
Ma joue collée contre le parquet sablonneux, j’aspire à devenir le meilleur des microscopes. Surprise, à force d’effort oculaire : le minuscule éclat de bois se révèle à moi, cassé en forme de crochet, il retient un fil blanc étiré. N’ayant qu’une seule main disponible pour pratiquer l’extraction – il ne faudrait pas que la fourchette touche le sol, tout serait à recommencer – je visualise la séquence que je devrai accomplir. Je respire profondément, j’expire mûrement. Allez! lentement, délicatement…
***
Assis à cette table carrée, devant le travail de crochet, avec la vapeur d’eau qui s’échappe toujours de mes macaronis – le contraire aurait été effroyable – et mon bas, intact, au pied, je parviens à me détendre. Mon bras gauche trouve appui sur cette même table, posé parallèlement à ses contours. Les gens aux bras ballants, comment font-ils pour vivre avec ces charges molles à leur côté? Comment faire pour manger escorté d’un membre inerte et pendouillant? Le dos raide, j’observe ma fourchette qui se plante dans la chaleur hachée de mon repas; la patience paiera toujours.
II
STAEDTLER 3HB
Le boulevard René-Lévesque et la Grande-Allée se posent, perpendiculaires à ma vie. Mon Univers s’insère entre deux intersections. Je n’ai besoin, pour subsister, que de la rue Cartier, soit 0,3 kilomètre d’existence. Cartier est une rassurante tranchée. Merveilleuse, cette rue. Merveilleuse au point où même si l’on se place à l’une de ses extrémités, on parvient toujours à apercevoir l’autre : s’étale ainsi devant moi un Monde immuable, connu. Si Cartier devait être associée au quartier Montcalm, pourquoi y aurait-il, à seulement quelques mètres l’une de l’autre, deux pharmacies? Deux épiceries? Pourquoi cette nécessité de reproduire des boutiques semblables quelques mètres plus loin, si ce n’est pour rendre Cartier unique, infranchissable, autosuffisante? Cartier est à elle-même une colonie d’après-guerre. Elle est un camp de réfugiés.
Lors de la période estivale, mon 2½ se transforme, au même rythme que les bourgeons deviennent feuilles, en un trois pièces. Je me permets alors une sortie sur le balcon de contreplaqué gris. Les mains posées sur la rambarde, je respire cette pièce ensoleillée. Du haut de ma tour d’ivoire, je me fonds dans la masse.
Sous mes yeux, les gens passent, se bousculent et ne regardent jamais où ils vont. Il y a fort à parier qu’ils ne connaissent pas vraiment Cartier. Bien sûr, ils sont au fait de la position géographique des boutiques qu’ils fréquentent toutes les semaines, mais ils ignorent tout de celles dans lesquelles ils ne sont jamais entrés. Si leur vie en dépendait, ils ne parviendraient probablement pas à tracer une carte exacte de cette rue. Dans cette optique, je m’entraîne. Chaque dimanche de huit heures à midi quinze, je m’installe à ma petite table carrée avec un crayon Staedtler 3HB et je l’esquisse.
Je trace le café Krieghoff qui prend vie sous l’Auberge du même nom. Sur la feuille écrue, j’en reproduis la façade. Tout en haut, je dessine les trois étoiles qui se tiennent bien droit sur leur affiche de bois bourgogne, suspendue au bout d’un bras de métal forgé. Je n’oublie jamais les trois petites tables posées sur le trottoir, signes que l’été s’est bel et bien ancré au bitume. Si je venais à les omettre, ce serait dessiner le Krieghoff en paysage d’hiver et rien ne serait plus faux. Je passe la matinée à faire l’ébauche de cette rue que je connais plus que par cœur.
L’après-midi, l’heure des courses. Tout doit entrer dans un seul sac. Un seul sac pour la semaine – mis à part, bien sûr, mon achat quotidien du délectable repas congelé qui, lui, se voit attribuer un sac à part, évidemment. Mon sac réutilisable en main, je sors par l’escalier de secours de l’édifice. La porte avant m’apparaît trop familière; des gens pourraient me voir en sortir et penser que j’ai visité un ami, quelle tristesse.
Tout comme la porte qui s’ouvre sur lui, l’escalier n’a été peint qu’une seule fois lors de sa construction. Depuis, la peinture s’envole au même rythme que les années. D’ici peu, il ne restera que le bois gris pour encaisser mes pas. Je déteste prendre cet escalier. Les odeurs des autres, partout. Le gravier du stationnement arrière roulera bientôt sous mes pieds. Trois paliers me séparent du sol et sept pas m’éloignent de Cartier, dont trois sur ce gravier. Ce sont les seuls sept pas que je m’accorde hors de cette terre connue. Il me serait insupportable d’en faire huit, dix. Il ne me faut jamais sortir aux heures de grand achalandage. J’aime me fondre de haut dans la foule, mais je déteste en faire partie.
III
PERSPECTIVE
…cinq, six, sept. Les deux pieds sur le trottoir de la rue Cartier, je respire enfin. Le soleil réchauffe le plastique de mon sac réutilisable glissé sous mon bras. Jusqu’à tout récemment, il me fallait marcher accompagné d’un sac qui ballottait au gré du vent : vide, il n’offrait aucune résistance à la brise aléatoire, l’horreur. Je ne pouvais prévoir ses mouvements. Le temps m’apparaissait interminable. Je tenais fermement ses poignées de tissu et alors que je m’appliquais à réguler mes gestes, lui dansait au bout de mon poignet, sur le rythme offert par la nature. Le problème se réglait à la suite de mon passage à la pharmacie, une fois mon sac rempli, je reprenais confiance.
Les choses changèrent pour le mieux dimanche dernier. Une passante, qui possédait un sac identique au mien, était aux prises avec le même ennui : un sac indiscipliné qui se dandinait en suivant les courants d’air. La voyant ainsi, j’eus alors l’impression qu’il y avait une justice dans ce monde; à tout le moins, je n’étais plus seul. Non seulement son malheur me porta réconfort, mais dans les instants qui suivirent, la passante m’exorcisa. Son sac venait tout juste de cabrioler sur son genou. En réponse à cet affront, elle cessa net de marcher. D’un geste vif, elle prit le sac à deux mains et le plia trois fois pour finalement le glisser sous son épaule. Dieu m’offrait une solution à mes souffrances. Cette simple passante n’était nulle autre qu’une envoyée du Seigneur. L’Homme dominait la nature, le sac ne s’animait plus.
Il m’aurait fallu penser à cette innovation des années plus tôt, j’aurais ainsi évité l’anxiété du changement qui m’habite depuis maintenant sept jours. Quoique quelque peu inquiet – l’adhérence du sac sous mon bras n’ayant toujours pas été démontrée de façon certaine – j’avance tout de même promptement. Il me faut tout d’abord marcher jusqu’à l’intersection formée par René-Lévesque et Cartier puisque je n’effectue jamais d’achats de ce côté-ci de la rue.
Mon sac sous le bras, il ne semble toujours pas vouloir glisser, je traverse Aberdeen et passe devant le nouveau restaurant situé tout juste sur le coin de la rue. Cet espace me fait honte. Aucun restaurateur ne parvient à y survivre plus d’un an. Ils brisent, propriétaire après propriétaire, l’immuable de cette rue. Il s’agit du seul endroit que je ne dessine pas lors de mes séances dominicales de croquis. Je préfère ignorer cet éléphant blanc et esquisser un grand arbre à la place; un petit parc serait beaucoup plus joli que cet immeuble à la fonction inachevée.
L’odeur de la brûlerie, celle située tout juste avant l’animalerie, me séduit. J’en raffole. Chaque fois, je me surprends à penser qu’il est bien dommage que cette boutique ne vende pas d’instantané. Poussé par cette idée mercantile, j’y suis entré, une fois, pour parler affaires. Le commis ne s’intéressa pas à mon projet de commercialisation, il préférait m’entretenir de la finesse du grain, de la torréfaction et d’autres balivernes. L’idiot ne comprit aucun des tenants principaux de mon plan d’affaires, il paraissait nier le fait que le marché du café instantané les ouvrirait au Monde. Ignare.
Depuis, je ne fais que humer leur boutique, mais je n’y remettrai jamais les pieds. Il me faut simplement rester dans l’embrasure de la porte pour saisir toute la subtilité des grains de café. Il me suffit de m’adosser bien droit au cadre d’aluminium. Ainsi, les clients peuvent tout de même entrer et l’espace est suffisamment large pour que je ne sois pas physiquement en contact avec eux. Il n’y a pas à se plaindre. De cette façon, je m’assure que l’âne-commis ne me vole pas mon idée : s’ils venaient à vendre de l’instantané, je pourrais réclamer mon dû.
Une dernière bouffée d’air caféiné et je quitte ma position. À quelques pas de là, les chatons jouent dans la vitrine de l’animalerie, posée à ras le sol.
Ce sont toujours les chats qui sont mis à l’avant-scène dans ce genre de boutique. On croirait qu’il s’agit d’une règle : choisir les plus petits chats et les placer à la merci des regards gras des dames trop fardées. Les spécialistes se surprennent encore du caractère antisocial du chat. Le phénomène m’apparaît bien simple pourtant : confrontés tous les jours à des ooooh qu’il est mimi le minet!, ils se lassent de la race humaine. Comment aimer un être si benêt? En plus, ici, les chatons se retrouvent derrière des fenêtres posées au niveau du trottoir. Cet emplacement contraint les vieilles dames à se contorsionner pour parvenir à torturer les petites boules de poils de leur regard monstrueux. Et quand ce n’est pas le troisième âge qui les enveloppe d’amour boule à mite, les gros chiens écrasent leur truffe mouillée sur le verre, comme pour défoncer la paroi. Je détesterais me réincarner en chat de vitrine.
Le soleil de fin de journée me réchauffe la nuque. Je sens les quelques gouttelettes d’eau qui perlent sous mon aisselle, humectant mesquinement le tissu de ma chemise. Je m’empresse de dire un dernier au revoir aux chatons. Le feu de circulation situé quelques mètres plus loin tourne au vert, s’ensuit le vrombissement des voitures. Le bruit s’étouffe sous les voix des femmes qui crient à leurs enfants de ne pas traverser la rue. Têtes brûlées.
Mes quelques pas me mènent à la droite de la station-service du coin. Cette entreprise m’a toujours posé problème : à quel quartier cette hypocrite station-service appartient-elle? Cartier ou l’Autre? L’automobiliste peut y entrer par la rue Cartier évidemment, mais il lui est aussi possible de le faire par René-Lévesque. Deux allées pour accéder au stationnement, pourquoi? J’en suis à penser que les stations-service doivent respecter les mêmes normes que les édifices à logements : il leur faut offrir une sortie de secours.
Au bout de ma route, j’atteins, non sans hâte, l’intersection. Je glisse ma main sur le poteau de métal lisse, la petite lumière ronde s’allume. Ce geste me déplaît, tant de gens l’ont fait avant moi. Je compte les secondes. Les feux de circulation ont cela de bien, l’immuabilité. Au compte juste, les chiffres se mettent à s’écouler. Vingt-sept secondes pour traverser Cartier.
Autour de moi, des gens passent, me dépassent, à gauche, à droite. Peut-être trouvent-ils mon pas trop lent? Au contraire d’eux, je profite de chaque seconde de cette traversée. Les concepteurs de ce feu m’octroient vingt-sept secondes, je compte bien les utiliser toutes. Les semelles de mes souliers se décollent avec lenteur du bitume chaud, je tiens mes bras le long de mon corps, je le rappelle, je déteste les bras qui ballottent. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, sous mes pieds, le côté est de Cartier. La tâche sera longue.
Les portes coulissantes de la pharmacie s’ouvrent devant moi. Le mélange aseptisé de shampoing et de parfum acide m’emplit les narines. Seules trois rangées se mériteront mon attention. Auparavant, je les parcourais toutes, selon un ordre précis. Puis, au bout de quelque temps, celui qui s’autoproclame « gérant » se vit « dans l’obligation » de m’interpeller. Il semblait que mon attitude inquiétait les clients. Je n’ai jamais vraiment compris la nécessité de son intervention. Comment aurais-je pu inquiéter? Comment aurais-je pu inquiéter?
À cette époque bénie, c’est-à-dire avant l’altercation avec le présumé gérant, j’aimais traverser toutes les allées, plusieurs fois. Je caressais un objectif secret : il me fallait apprendre leur contenu par cœur, cette information aurait pu m’être plus qu’utile en temps de guerre. Dans le but d’éviter la cohue, elle pourrait me permettre de dresser un plan de survie afin de me diriger efficacement dans cette boutique pour y acquérir les articles clefs. Seulement, paraît-il, j’effrayais les gens. Pourtant, ce n’est pas eux que je fixais, ce n’est pas devant eux que je fermais les yeux en répétant rapidement l’ordre des produits. Qui aurais-je pu déranger, les yeux fermés, murmurant tout bas? Malgré mes tentatives apparemment vaines d’explications, le gérant me menaça. Il ne me fallait plus mémoriser le contenu de la pharmacie. Pour le citer, je devais venir à « toutes fins pratiques » et « être efficace ».
À ma droite, j’agrippe un petit panier vert. Les broches de métal froid s’immiscent dans le pli de mes jointures. Direction, allée trois.
L’important, chaque dimanche, est de me procurer les mêmes articles. La liste d’achats doit rester la même, toujours la même. Autrement, comment pourrais-je faire mon budget? Ils me tuent avec leurs rabais. Je déteste les escomptes.Elles s’inscrivent sur la liste pernicieuse des choses que je haïs le plus, rivalisant avec ces gouttes qui parfois se détachent de la pellicule de mes repas congelés. L’irrégularité de leur arrivée en magasin a quelque chose de diabolique. Elles surgissent, sans crier gare, et aspirent à nous rendre heureux, comme Satan qui, sous un pacte alléchant, cache de bien sales machinations. Rien de moins. Tout ceci n’est que mensonge, un habile subterfuge de commerçant véreux. Un mensonge écrit trop gros sur du papier trop jaune. Les escomptes m’empêchent de tenir un budget serré, invariable. Pourtant, tous les établissements financiers l’affirment : il faut s’en tenir à son budget! Ces « rabais-surprises » m’en privent. Ils diminuent le montant prévu de mes achats, qu’en ai-je à faire de cet argent? Il devait être utilisé, il était calculé pour être utilisé. Malgré tout, bien que les escomptes soient l’œuvre de l’esprit du Mal, sachez qu’il y a pire, bien pire. Les « objets-bonus », les « en-prime » et tous ces « obtenez 20% de plus », ils ne pourraient me persécuter davantage. Ces quantités superflues qui s’écoulent plus lentement que prévu s’accumulent : elles nuisent à mon inventaire.
L’allée numéro trois se présente à moi dans un blanc aveuglant. Les néons ubiquistes attaquent ma rétine de toutes parts. Je sens ma pupille se recroqueviller et tenter de faire imploser mon œil. J’approche mes paupières l’une de l’autre, à la manière d’un félin irrité, et me dirige jusqu’au centre du couloir étroit. Les murs de métal s’irisent de chaque côté de mon corps. J’écoute le bruit de mes pas sur le carrelage blanc. L’objet de ma quête se trouve sous l’affiche bleue annonçant le contenu la rangée. Troisième rangée depuis le haut, je tends le bras puis le déplace de quelques degrés vers la droite. Voilà. J’ouvre légèrement les paupières : merveilleux, prix courant, aucune trace de jaune. Le choc du déodorant tombé au cœur du panier vide fait résonner les poignées de métal. Compter cinq pas.
Accrochés à l’extrémité d’une des étagères pendouillent les sacs de quinze rasoirs jetables. Je saisis ceux pour peaux « extra-sensibles » et, dans le même mouvement, plie les genoux. J’adore cet instant, j’entends le Boléro de Ravel qui m’éclate la tête. Ce moment a quelque chose de gracieux, j’aspire à décrocher le sac d’un geste de la main et à compléter la génuflexion en un même et glissant geste. Puis, de l’autre main, je capture un tube de crème à raser, lui aussi pour peaux « extra-sensibles », avec les trois doigts restés libres de la main tenant les rasoirs. Satisfait de ma routine, je déplie mes jambes et, le dos bien droit, dépose les deux articles dans le gouffre vert. Entrer dans la rangée quatre. Dernier arrêt. Je marche jusqu’à l’extrémité de la rangée incandescente. Rotation vers la droite, quelques pas, tout au bout, des attaches à cheveux dansent sur des tourniquets. Une dernière rotation vers la droite. Rangée quatre. Un panneau identique au précédent se retient à deux chaînettes qui poussent depuis le plafond. Le chiffre quatre, bien au centre, m’invite.
Autant la rangée trois m’agressait de par l’intensité de son éclairage, autant la quatre viole les bâtonnets de mes yeux avec la démesure de sa palette pastel. Les créateurs de couleurs chez les quincailliers n’ont rien à envier aux fabricants de savon.
Avancer jusqu’au bout de l’allée cinq. Atteindre les barres de savon. Autour de moi, les bouteilles de nettoyant se confrontent. Les contenants anguleux séduisent les emballages aux formes provocatrices, toutes laissant transparaître leur contenu. Des perles flottent ici et là, les « tourbillons hydratants » rivalisent avec les « éclats de fraîcheur ». Rien n’est opaque dans le monde des gels pour le corps. Je dois marcher jusqu’à l’extrémité de l’allée pour retrouver les rassurantes boîtes de pain de savon. Je saisis celle placée tout en haut, comme isolée de cette rangée pervertie. Rangée quatre, dossier clos. Un, deux, trois, j’entre à peine dans la cinq et atteint, non sans un certain soulagement, le dernier article nécessaire. Au tout début de cette rangée se trouve l’ensemble pratique contenant une petite brosse à dents et le tout aussi petit tube de dentifrice dont j’ai besoin. Ce format est merveilleux, il suffit tout juste à une semaine d’hygiène dentaire. J’attrape à deux mains les anses du panier et le dépose sur le sol. Je fouille ma poche gauche en m’agenouillant :
Emplettes du dimanche, arrêt 1
- déodorant;
- crème à raser;
- 15 rasoirs jetables « peaux sensibles »;
- pain de savon;
- trousse de voyage pratique pour mon hygiène buccale personnelle.
J’utilise toujours la même liste, écrite sur ce papier vert. J’ai accumulé beaucoup de ces tablettes de papier, ils en laissent traîner partout au boulot : il faut limiter les pertes. Si ce n’était du logo de l’Institution dans le coin droit de chaque feuille qui brise l’harmonie de l’espace, le papier serait parfait, uniforme. La liste en main, je pose un à un sur le sol chaque article. Le déodorant, oui. Les 15 rasoirs jetables « peaux sensibles», oui. Le pain de savon, oui. Le gel à raser, oui. La trousse de voyage pratique pour mon hygiène buccale personnelle, oui. Je replie la liste.
Coup d’œil rapide par-dessus mon épaule, il n’y a qu’un seul client à la caisse. Je me relève après avoir pris soin de remplir mon panier à nouveau. Il me faut marcher rapidement. Cette vieille dame à ma droite, avec son panier roulant bourré qui menace de s’écrouler, n’aura pas ma place.
L’insolent devant moi termine sa transaction, grommelle un mot de remerciement et quitte le comptoir d’un air déterminé, précédé de sa lourde démarche. Se révèle alors à moi une caissière platine qui me sourit derrière son manque de pudeur.J’acquiesce simplement de la tête, les gens sont venus à penser que j’étais muet, la chose me va très bien. Je pose mon panier sur le comptoir, elle fera le reste du travail.
Retour sur le trottoir.
Restaurant, boutique, boutique, épicerie, restaurant, coin de rue, boutique, boutique, coin de rue. À ma gauche, quelques pas plus loin sur Aberdeen, la crèmerie. Des enfants, englués de chocolat jusque dans leurs chaussettes, tiennent chacun un cornet démesuré. À quelques pas de là, les parents exaspérés semblent heureux. Qu’en ont-ils à faire de tout ce sucre dans le ventre de leurs petits chéris; au moins la bouche pleine, ils se taisent. Le silence a toujours un prix. Coin de rue, restaurant, restaurant, ruelle, le mail.
***
Le mail fut construit avec trois accès principaux. Moi, je préfère entrer par la porte située à l’extrême gauche. À la fin de mes courses, je peux donc ressortir par celle du centre. Les clients, quant à eux, accèdent aux comptoirs-restaurants par la porte trois, à l’extrême droite. Penser que quelqu’un d’autre que moi pourrait préparer mon repas me répugne : je ne mettrai jamais les pieds de ce côté. Ainsi, la porte centrale, planche de salut qui m’évite de croiser le moindre cuisinier, est une merveille d’architecture.
Depuis maintenant quelques secondes, j’attends que quelqu’un sorte afin de me glisser dans l’entrebâillement de la porte un. Vu son poids, j’évite de me fatiguer en l’ouvrant moi-même. Notez que l’entrée centrale, elle, est automatique. De toute manière, tous semblent prendre plaisir à me faciliter l’entrée. Parfois, ils me sourient en retenant la porte, alors, je joue au muet et je hoche la tête, harassé comme si je portais le poids du monde sur mes épaules. Mon mutisme se supporte parfois difficilement. Une fois à l’intérieur, je passe devant la poissonnerie où des gens en tabliers bleus et en chemises rayées vendent une impression de fraîcheur marine : vous ne me bernerez pas, ils sont bien morts vos poissons.
Devant la brûlerie, une vieille dame aspire un café inondé de lait. Sur mon passage, elle soupire en soufflant sur la fumée imaginaire de son café devenu froid. De son doigt tremblant, elle cogne sur la table, battant la mesure d’un temps infini qui ne s’écoule plus. Me voilà, non pas sans soulagement, dans l’épicerie du mail. Je ressors la liste de ma poche, dans l’énervement, il faut être prêt :
Emplettes du dimanche, arrêt 2
- 7 fruits;
- 7 berlingots de lait;
- pichet de jus d’orange de 2 L;
- repas congelé.
À l’entrée, juste après le tourniquet, se trouve la pile de paniers, comme pour la pharmacie. J’en saisis un. D’abord les fruits. Je ne les aime pas, mais le Guide alimentaire canadien me contraint à en avaler. J’en choisis sept différents. Cela rend la chose moins désagréable, chaque jour, un goût différent que je déteste : banane, pomme, pruneau, 12 raisins en grappe, orange, pêche, poire. Je les tâte, tous. Je pose l’orange sous mon nez, je la hume. Toujours le même problème, que devrait-elle sentir? Pourquoi est-ce si commun de se foutre un agrume sous le nez?
Un pruneau indésirable dégringole alors que je saisis celui qui me plaît. Il tombe sur le sol. Le commis courbé, là-bas, s’en chargera. Je tourne les talons. Dans un mouvement trop brusque, la pomme verte roule dans mon papier et termine sa course embrassée par la courbe de la banane. Il ne me reste qu’à rejoindre les frigos. Les congélateurs en sont tout près. Je me réserve toujours l’achat du repas congelé pour la fin. Au fil des années, j’ai appris à faire durer le plaisir. Il ne faut rien précipiter.
Devant les frigos, j’entreprends de retirer tous les berlingots de lait du présentoir. Les meilleurs se trouvent à la fin. Une histoire de date et de rotation. Je ne souhaite pas me risquer avec un berlingot dont la date d’expiration serait trop près. J’en prends sept, les sept du fond. Je replace tous les autres extirpés de leur tablette de néon, incognito. Le pichet de jus d’orange se trouve juste en dessous. Je n’ai rien à craindre, l’acidité de l’orange tue tout être indésirable qui envisagerait de s’y établir. Bien que je n’aime pas les fruits sous leur forme terrestre, leur jus ne m’apparaît pas si mal.
Devant moi se dresse le congélateur.