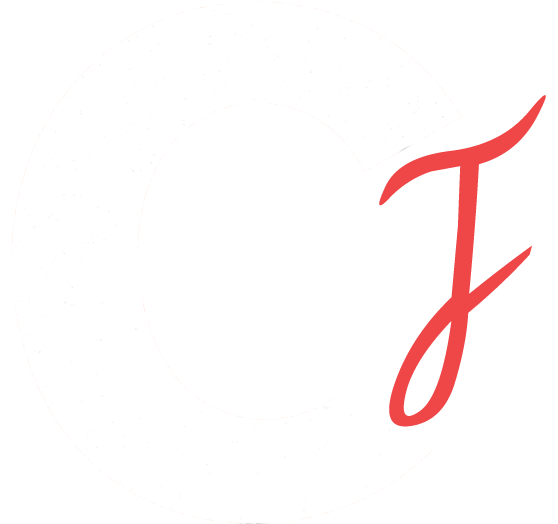Le Crachoir de Flaubert accueille des chercheur-créateurs ou des chercheure-créatrices en résidence qui bénéficient d’un espace privilégié pour explorer les différentes possibilités de sa double posture. La résidence est un lieu virtuel que l’artiste peut investir de la manière qui lui convient le mieux. À mi-chemin entre le blogue, la chronique et le feuilleton, cette résidence permet à l’artiste d’exposer à un vaste public les résultats de sa réflexion ou de sa création, les hypothèses qui sont les siennes, ses coups de tête et ses coups de gueule concernant la recherche-création. Ce lieu unique au monde lui appartient le temps de son séjour parmi nous et les propos tenus ici n’engagent que l’artiste, qui a carte blanche pour créer et réfléchir.
Pour postuler à cette résidence, en tout temps, veuillez contacter l’équipe avec une courte description de votre projet en écrivant à l’adresse suivante : contact@lecrachoirdeflaubert.org
Chercheurs-créateurs et chercheures-créatrices en résidence
2014 : Cassie Bérard
2015 : Vincent Mauger
2016 : Danielle Boutet
2017 : Chloé Savoie-Bernard
2017-2018 : Nicholas Giguère
2018 : Naomi Fontaine
2019 : Fanie Demeule
2019 : Valérie Forgues
2019 : Stéphane Ledien
2020: Sara Lazzaroni
2020: Sébastien Emond
2021: Maude Déry
2022: Mattia Scapulla
2022: Maude Deschêne Pradet
2022 : Anne-Marie Desmeules
2023 : Lux
2023 : Alex Thibodeau
2024 : Jessica Dufour
2024-2025: Maxime Plamondon
2025: Lily Pinsonneault
2025: Geneviève Dufour