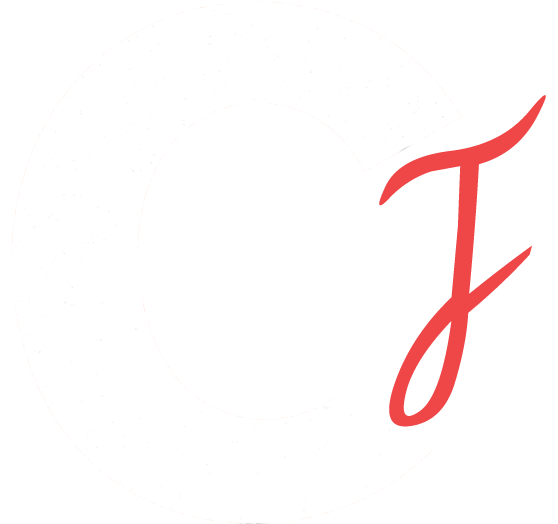Asimov, Perec et moi — Conférence de Martin Winckler en baladodiffusion
Martin Winckler amorce ce cycle de trois conférences en démythifiant le génie artistique de l’écrivain dont l’inspiration tombe du ciel pour parler du « métier » d’écrivain. Si Martin Winckler est ce curieux personnage que l’écrivain a ressuscité (ah les pouvoirs de la médecine!) de la fiction de Georges Perec, il est aussi ce personnage qui permet à Marc Zaffran d’entrer en fiction puisque c’est le nom avec lequel il signe ses textes littéraires. Cet emprunt du pseudonyme de l’écrivain à Perec n’est pas anodin puisque l’auteur parle ouvertement de ses influences et des leçons qu’il a apprises lors de ses lectures d’Isaac Asimov et de Georges Perec.