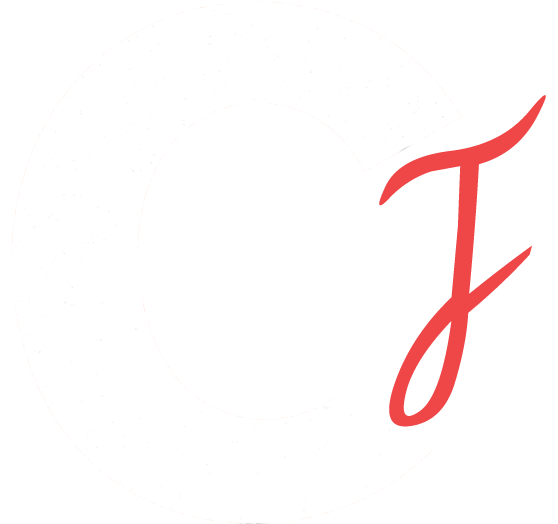S’in-dé-finir
La règle du masculin l’emportant sur le féminin dans la langue française, par exemple, n’est pas un accident ou le reflet d’un ordre naturel. Elle y transpose le rapport de domination que la classe des hommes exerce sur celle des femmes (Wittig, 1992), pour emprunter la terminologie du féminisme matérialiste. Elle le répète, le rappelle, le banalise donc en lui donnant une forme structurelle et en l’inscrivant dans une pratique quotidienne.